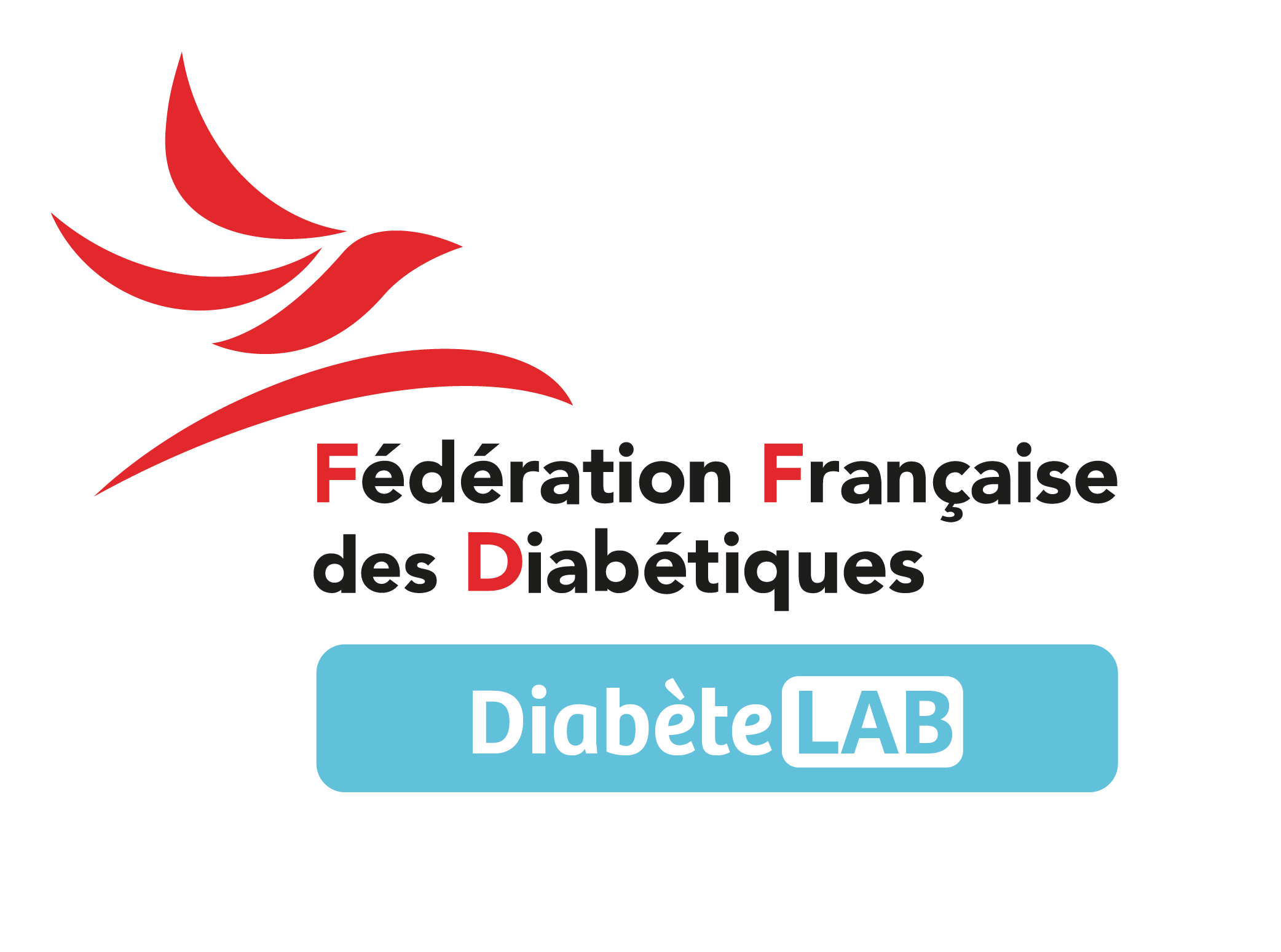Interview croisée de Nicolas Naïditch et Guillaume Montagu
Comment la sociologie enrichit-elle la recherche médicale ? Comment l’innovation thérapeutique peut-elle naître des études de terrain ? Comment les intérêts des patients trouvent-ils la juste médiation via les sciences sociales ? Comment et pourquoi construire des questionnaires qui évaluent la santé des patients (PRO : Patients Reported Outcomes) ? Des questions qui ont été posées à Nicolas Naïditch, docteur en sociologie et responsable du Diabète LAB au sein de la Fédération Française des Diabétiques et à Guillaume Montagu, directeur de la recherche chez unknowns, sociologue spécialiste de la santé. Explications.
→ Nicolas, pour ceux qui ne connaîtraient pas le Diabète LAB, peux-tu rapidement nous en parler ? Pourquoi une association de patients se dote-t-elle d’une structure de recherche ?
Nicolas : Monté il y a bientôt 7 ans la création du Diabète LAB part d’un constat assez évident : généralement, les projets et dispositifs que les industriels proposaient à la validation de la Fédération et de ses patients n’étaient pas co-construits en amont avec eux, et ce alors qu’ils leur étaient destinés. La Fédération a donc identifié l’opportunité de créer un living lab* permettant de co-construire et de co-évaluer les projets et dispositifs avec les patients, en amont des projets et tout au long de la chaîne d’innovation. Mais aussi de produire de la connaissance (des études) en propre, en adoptant de bout-en-bout une perspective patient. Naturellement, pour identifier et faire valoir les besoins des usagers de l’association, le choix des sciences humaines et sociales – et en l’occurrence de la sociologie – comme discipline de recherche s’est rapidement imposé.
« Les gens n’ont pas toujours conscience de ce qui les fait agir. »
→ Pourquoi a-t-on besoin des sciences sociales ? Pourquoi ne suffit-il pas de demander aux patients ce qu’ils pensent, vivent, ou souhaitent ?
Guillaume : Les gens n’ont pas toujours conscience de ce qui les fait agir. Il vont décrire ce qu’il se passe dans leur vie, mais il y a des choses qu’ils n’arrivent pas à penser ou simplement à exprimer. Et puis, et c’est tout-à-fait normal, lorsqu’on est tiraillé par des intérêts contraires, il arrive qu’on se mente à soi-même, sans forcément s’en rendre compte, d’ailleurs. C’est tout l’intérêt des sciences sociales, qui font appel à des outils et méthodologies qui permettent à la fois de questionner ce que les gens disent, d’étudier leurs pratiques, d’analyser les situations vécues… plutôt que les discours. Et ce non pas seulement à l’échelle d’un individu mais de populations entières.
« L’idée, c’est que nous ne vivons pas tous de la même façon. Et les injonctions faites dans nos rôles sociaux diffèrent selon qui nous sommes. »
→ Comment les sciences sociales, au sein du Diabète LAB, permettent-elles de faire avancer la prise en charge des patients ?
Nicolas : Pour rebondir sur ce que disait Guillaume, notre job est notamment de produire de la connaissance sur l’environnement des personnes et sur ce qui va avoir une influence dans leurs comportements. Bien entendu, au bout de la chaîne, cela permet de trouver des leviers pour améliorer la qualité de vie ou les parcours de soins, mais aussi de mieux évaluer les dispositifs médicaux. Dans le diabète, chaque année, des évolutions technologiques voient le jour, comme le capteur de glucose en continu ou encore de nouvelles pompes à insuline. Notre rôle est de comprendre comment les patients peuvent se les approprier et éventuellement de faire des retours aux partenaires industriels afin qu’ils améliorent leurs dispositifs en fonction de leurs vécus. Souvent, pour l’expliquer, je prends cet exemple : une certaine proportion de femmes souhaitent pouvoir piloter la pompe à insuline via un smartphone. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’elles l’accrochent à leur soutien gorge quand elles sont en robe – et non à une ceinture – ce qui les contraint à se déshabiller à l’abri des regards, par exemple aux toilettes, pour pouvoir agir sur le dispositif.
L’idée, c’est que nous ne vivons pas tous de la même façon. Et les injonctions faites dans nos rôles sociaux diffèrent selon qui nous sommes. Si on ne fait pas émerger le mécanisme social qui explique l’inadéquation du dispositif à la vie des personnes, si on ne l’objective pas, alors il y a peu de chances que le dispositif médical évolue.
Guillaume : Et surtout cela permet de pointer la bonne cause ! Souvent la tentation est forte de prescrire des séances d’éducation thérapeutique, là où, au final, dans ce cas précis, ce sont aux industriels d’adapter les dispositifs à la vie des personnes.
→ Comment cette connaissance peut-elle permettre l’émergence d’innovations ?
Nicolas : C’est compliqué de répondre à cette question parce qu’il faudrait savoir ce qui est imputable aux sciences humaines, à la médecine ou à la recherche clinique, etc. Mais ce qui est sûr, c’est que le terrain est source d’innovations. Avant, par exemple, lors d’une crise d’hypoglycémie sévère, il fallait qu’un tiers ouvre votre réfrigérateur, prenne une seringue et vous fasse une injection sous-cutanée ou intramusculaire de glucagon. Il fallait donc ne faire des crises d’hypoglycémie que chez soi, avec un proche rompu à l’exercice. Aujourd’hui, le traitement, sous forme de poudre, peut se prendre par voie nasale et il n’a pas besoin d’être conservé au réfrigérateur. Ce qui a été contourné ici, ce sont des difficultés d’appropriation du traitement, sa portabilité mais aussi la facilité d’administration par un tiers. Au final, cela apporte une amélioration significative de la qualité de vie. Le diabète est une maladie qu’on connaît depuis longtemps. Les recherches portent désormais bien plus qu’avant sur les modes d’administration – et donc finalement la qualité de vie – que sur les molécules en elles-mêmes.
Guillaume : Oui, alors qu’en règle générale, en recherche et développement, l’attention est avant tout portée sur les molécules. Dans les essais thérapeutiques et les études, il y a très peu d’items liés aux voies d’administration ou à l’observance. Pour moi, l’un des champs d’investigation des sciences sociales, c’est justement de mener des recherches pour permettre l’évolution des stratégies de prise en charge et l’amélioration de l’observance.
→ As-tu un exemple à nous donner ?
Guillaume : C’est typiquement ce que nous avons fait dans le champ des rhumatismes inflammatoires chroniques. Ce que vivent les patients atteints, c’est une prescription à l’hôpital, suivie d’une délivrance en ville, avec des rendez-vous chez leur spécialiste tous les 6 mois. Mais que se passe-t-il entre temps ? Ils ont à prendre des décisions, sans l’aide de leur médecin, en ne comptant que sur leur propre expertise de la maladie.
C’est pourquoi nous avons créé Hiboot, une application qui les aide notamment à résoudre les dilemmes médicaux, par exemple : dois-je prendre mon traitement si je me suis coupé en faisant la cuisine ? Avec pour objectif d’améliorer l’observance, d’améliorer la sécurité des traitements, et avec des bénéfices qui sont globaux pour la santé. En théorie, la sécurité et l’observance c’est simple… mais en pratique, à l’échelle de la réalité et des personnes, ça l’est beaucoup moins.
« Les personnes ont plus de probabilités de prendre leur traitement parce qu’elles y adhèrent, parce qu’elles lui donnent un sens… »
→ Existe-t-il des projets similaires, liés au diabète, par exemple ?
Guillaume : Une réflexion est en cours avec un néphrologue, qui a pris contact avec nous pour réaliser une application à destination des transplantés rénaux – majoritairement des personnes diabétiques. La problématique est la suivante : 30 % des rejets de greffe sont imputables à une mauvaise observance des traitements immunosuppresseurs. Nous avons fait un terrain exploratoire pour comprendre quel était le parcours du transplanté rénal. L’une des conclusions, c’est que les personnes vivent leur greffe comme une “guérison”, un soulagement, alors qu’ils sont toujours atteint d’un diabète, avec a fortiori des tâches de soins supplémentaires dues à leur statut de transplanté rénal. La question c’est : comment bien prendre un médicament alors qu’on pense être guéri ? Nous pensons que ce sont tout un tas de choses qui se construisent bien avant la transplantation. On aimerait que ce projet prenne vie, et c’est justement l’une des raisons de notre présence au congrès de la Société Francophone du Diabète (SFD) cette année, pour aller à la rencontre d’associations de patients, de médecins et de laboratoires qui pourraient nous aider à le développer.
Nicolas : J’aimerais rebondir sur la notion d’observance. Elle est incontournable dans nos métiers mais cependant, j’y adjoins toujours la notion d’adhésion, comme un facteur supplémentaire à la bonne observance. Pour faire court, les personnes ont plus de probabilités de prendre leur traitement parce qu’elles y adhèrent, parce qu’elles lui donnent un sens…
→ L’un des rôles du médecin n’est-il pas justement de favoriser les conditions de l’adhésion au traitement ?
Nicolas : En France, nous avons un problème d’ordre culturel. Certes, les patients sont plutôt bien pris en charge, mais il y a assez peu de temps médical disponible pour accompagner les patients. On le voit dans l’insuffisance cardiaque, par exemple. Les patients passent 15 minutes tous les 6 mois avec leur cardiologue. En conséquence, ils ne savent pas exactement de quelle pathologie ils souffrent, et ne savent pas l’expliquer. Comment alors, dans ces conditions, développer de l’adhésion thérapeutique, faire de l’activité physique adaptée après une intervention, surveiller son apport en sel dans son alimentation, surveiller sa pression artérielle… et au final éviter une intervention chirurgicale, voire une réintervention ? Aujourd’hui, on parle beaucoup des PRO (Patient Reported Outcomes). On pourrait complètement les utiliser pour évaluer les solutions d’accompagnement, par exemple.
« C’est déjà un PRO que de demander à un patient comment il se sent, s’il va bien. »
→ Pouvez-vous rapidement rappeler ce que sont les PRO ? Et pourquoi cela intéresse-t-il le sociologue ?
Guillaume : Selon la FDA (Food and Drug Administration), un PRO, c’est toute mesure de l’état de santé du patient qui est rapportée directement par le patient. L’objectif est de collecter des données subjectives pour aider à mieux comprendre l’efficacité d’un traitement ou d’une prise en charge. Quand je dis subjectives, cela ne veut pas dire que ce n’est pas scientifique, évidemment, mais que la perspective adoptée est celle du patient – et là on commence à comprendre la légitimité des sciences sociales dans ce domaine. Finalement, les PRO, ce n’est pas nouveau… Un médecin avec lequel nous travaillons a l’habitude de dire que c’est déjà un PRO que de demander à un patient comment il se sent, s’il va bien… Sauf qu’en médecine, on a souvent pour habitude de privilégier les mesures objectives liées le plus souvent au corps, au biologique.
→ Pourquoi entend-t-on, en ce moment, de plus en plus parler des PRO ?
Guillaume : Cela vient en grande partie d’une politique volontariste de la part des autorités de santé, qui se sont mises à recommander à l’ensemble de l’écosystème – les établissements de santé, les industriels et les sociétés savantes – une meilleure intégration du vécu des patients dans l’évaluation de leurs médicaments, dispositifs et stratégies de soin. Mécaniquement, cela se reporte sur les PRO, qui sont l’instrument principal de cette intégration.
Nicolas : Pour compléter ce que dit Guillaume et entrer dans le détail, je vois 3 facteurs qui ont poussé le recours aux PRO. En premier, une tendance, plus ou moins dénuée d’intérêts commerciaux ou communicationnels, de prendre davantage en compte l’expérience et le vécu des patients. Cette fameuse “patient centricity” qu’on lit partout.
Ensuite, le fait que les PRO permettent de donner un caractère scientifique, grâce à la quantification, à des remontées subjectives de la part des patients. C’est un point fondamental pour les médecins qui ont été formés à l’objectivité, d’autant plus que cette dernière est souvent confondue avec le concept de scientificité. L’objectivité donne l’illusion d’une maîtrise et cela est rassurant pour les médecins.
Enfin – et c’est le cas en diabétologie – dans des aires thérapeutiques où les molécules des laboratoires sont peu ou prou les mêmes et où les thérapies, en soi, sont déjà excellentes… comment se démarquer en tant qu’industriel ? Eh bien si cela ne peut pas être sur le biologique, alors ce sera sur la qualité de vie. Voilà le mouvement de fond le plus important à mon sens, avec, en ligne de mire pour les laboratoires, un nouveau différenciateur.
→ Quelles sont les limites de cet engouement pour les PRO ?
Nicolas : On est dans un moment où chacune des équipes qui travaille sur une pathologie se dit qu’elle va faire mieux que l’autre et développe un nouveau PRO. De fait, il est impossible de tout connaître et l’ensemble est très hétérogène et manque d’harmonisation. Par ailleurs, il y a une problématique d’accès aux PRO, puisque des sociétés vendent les droits d’utilisation de leurs PRO. Sur des enquêtes à large échelle, cela pose clairement un problème de financement…
→ Quelle est la bonne question à se poser avant de se lancer dans la conception d’un PRO ?
Guillaume : Incontestablement celle de l’objectif qui est poursuivi. Quand nous nous sommes lancés dans le design d’une nouvelle échelle mesurant l’autonomie dans la Sclérose en Plaques (SEP), c’est parce que, avec nos partenaires, nous avons jugé que rien ne mesurait vraiment ce que nous avions identifié comme réellement important pour les personnes. Dit autrement, nous avons vu une limite des évaluations pratiquées en routine dans cette pathologie – qui traditionnellement mesure l’évolution du handicap et l’activité biologique de la maladie – là où l’étude liminaire que nous avions menée renversait complètement la manière d’approcher la pathologie, en mettant en avant l’importance de la notion d’autonomie pour les personnes.
« Il faut notamment que la répétabilité soit bien analysée pour éviter l’inflation des questions. »
→ À quoi ressemble un bon PRO ?
Nicolas : Un bon PRO, évidemment, c’est un PRO qui poursuit un objectif clair, Guillaume en a parlé. Mais si l’on veut se doter de critères en particulier, on peut parler de la longueur du questionnaire. Un questionnaire trop long, cela peut être rédhibitoire, surtout quand on commence à toucher des profils de patients spécifiques qui ont à remplir plusieurs questionnaires pour une étude donnée. Donc il faut absolument – et là on entre dans une partie statistique qui incombe également à la sociologie – que les propriétés psychométriques et notamment la répétabilité des questions soit bien analysée pour éviter l’inflation des questions.
Ensuite, il faut que le questionnaire fasse sens pour les patients. Et pour cela, les sciences sociales sont extrêmement bien placées pour identifier – comme dans le cas du projet auquel Guillaume a participé dans la SEP – les grandes thématiques et items qui vont être centraux dans la construction du PRO. Mais aussi la manière de les aborder, qui doit être adaptée à la compréhension des patients.
Enfin, un bon PRO, c’est un PRO utilisé à grande échelle. Ce n’est pas intéressant d’avoir un questionnaire utilisé seulement au sein d’une équipe, simplement parce qu’on ne peut pas comparer les résultats et leur évolution dans le temps.
→ Au final, quel est réellement le bénéfice des PRO pour les patients et les professionnels de santé ?
Guillaume : Nicolas parle évidemment des qualités extrinsèques d’un PRO, qui permettent, dans le domaine de la recherche, de tirer des conclusions générales pour une population. En complément, si l’on attribue aux PRO un objectif d’ordre clinique plutôt qu’un objectif de recherche, j’aurais tendance à dire qu’un bon PRO permet à une équipe thérapeutique de prendre des décisions. Car l’une des qualités intrinsèques de l’outil, c’est aussi de faire émerger les problématiques auxquelles le patient fait face, alors qu’elles sont invisibles avec les outils de mesure traditionnels – comme une IRM, une prise de sang, un test fonctionnel… Le PRO accède alors au statut d’outil d’enrichissement du diagnostic, et permet, dans le même temps, de proposer des stratégies de prise en charge différentes et réellement adaptées à la vie avec la maladie et le traitement. Et ce pour chaque binôme patient-professionnel de santé. Au final, un bon PRO, c’est celui qui permet d’articuler la vision clinique et l’épidémiologie…
Nicolas : En conclusion, on peut citer Philippe Rigoard, professeur de neurochirurgie au CHU de Poitiers, qui utilise une maxime à laquelle je pense souvent : “Pour traiter, il faut évaluer, et pour évaluer, il faut des outils”. Et si on n’a pas les PRO en pratique clinique pour évaluer les problématiques des patients, on ne pourra jamais les traiter.
Guillaume : Et je me permets d’ajouter : et si on n’a pas les sciences sociales, alors on a peu de chance d’avoir les bons outils. Voilà l’un des combats que doit mener la sociologie dans la santé.