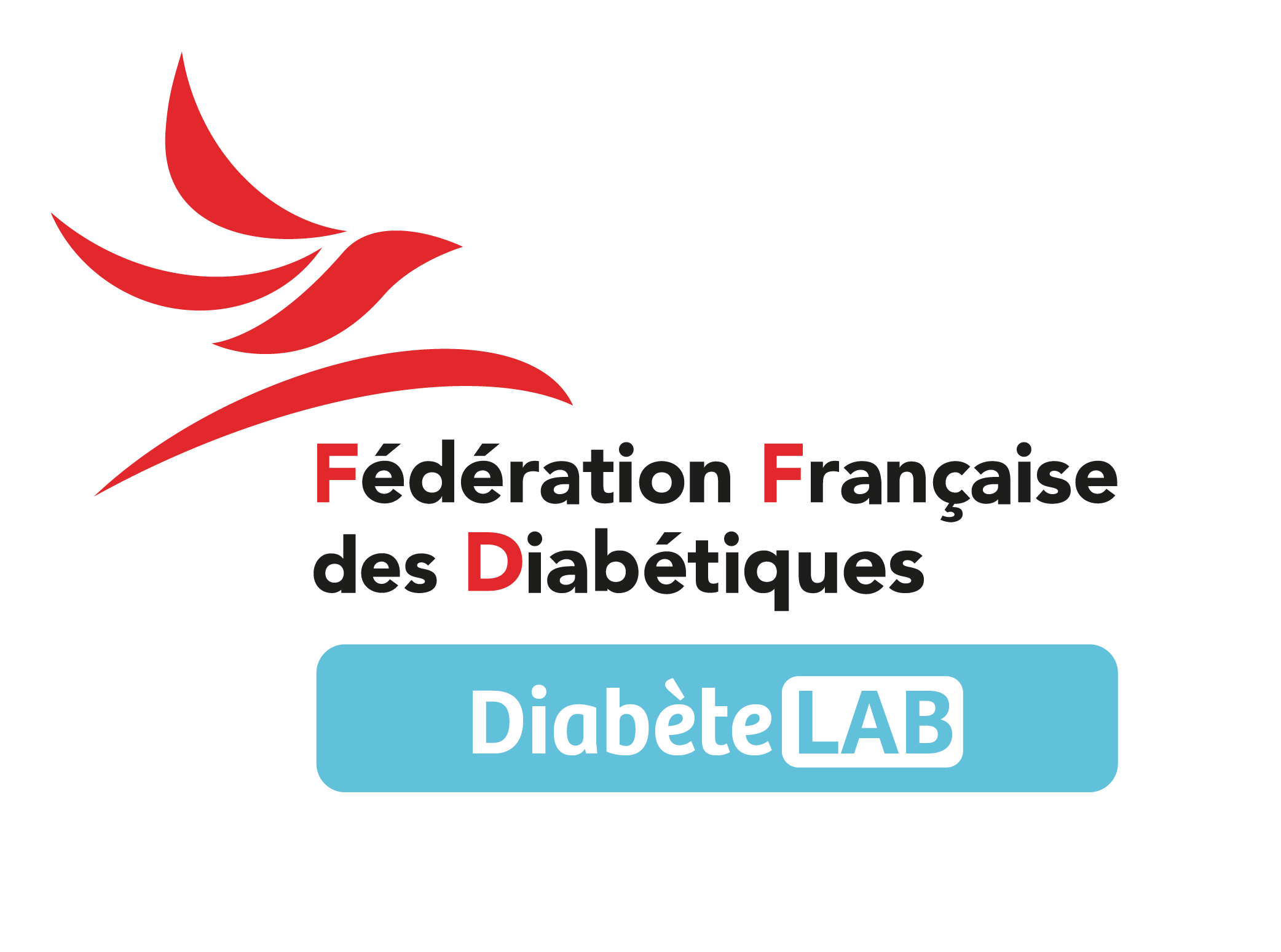La pharmacovigilance (PV) réside dans « la surveillance des médicaments et la prévention du risque d’effet indésirable résultant de leur utilisation, que ce risque soit potentiel ou avéré »[1]. Organisée en France autour d’une agence nationale et de centres régionaux qui en dépendent[2], la pharmacovigilance vit depuis le milieu des années 2010 une véritable révolution dans ses pratiques, avec la montée en puissance des canaux numériques. Nous faisons le point sur ces nouveaux usages, avec le Dr Nadine Petitpain, praticienne hospitalière au Centre régional de pharmacovigilance (CRPV) de Nancy, et le Dr Thierry Marquet, directeur de l’accès au marché de Shire France & Benelux.
En quelques années seulement, l’émergence du numérique a radicalement transformé la pratique de la surveillance du médicament (la pharmacovigilance au sens strict) et des dispositifs médicaux (la matériovigilance), ainsi que de leur cousine la pharmaco-épidémiologie.
La révolution des réseaux sociaux et du smartphone
Des plateformes web comme ComPaRe organisent de grandes cohortes et font remonter de façon quantitative des informations délivrées par les patients sur leur ressenti, permettant d’identifier les effets indésirables de traitements contre des maladies chroniques.
Parallèlement, un traitement plus qualitatif de la parole des patients, comme celui que propose le Diabète LAB, apporte un éclairage plus précis encore sur leur maladie, sur la façon dont leur prise en charge et l’utilisation de dispositifs médicaux impactent leur quotidien, sur des effets indésirables plus globaux. Des sites internet communautaires, comme Carenity, incitent pour leur part à participer à des essais cliniques, dont les résultats viendront eux aussi contribuer à la pharmacovigilance.
« Ce qui bouleverse tout, ajoute le Dr Marquet, c’est l’arrivée depuis 10 ans de la révolution des réseaux sociaux, de la portabilité, du smartphone. On découvre de nouvelles possibilités de déceler des signaux faibles ou précoces qu’on détectait peu ou pas du tout à travers la seule déclaration des professionnels de santé et des industriels. »
Étudier les effets des médicaments « dans la vraie vie »
Pour encadrer ce foisonnement numérique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a lancé en 2017 une plateforme de déclaration directe par les patients, le Portail de pharmacovigilance de la Direction générale de la santé. Ainsi, tout ce qui advient en aval d’une prise de médicament est aujourd’hui plus que jamais scruté, recueilli et finement analysé… « Lorsque la situation est ‘normale’ – c’est-à-dire en dehors des périodes de crise sanitaire – l’adhésion du patient à la démarche de pharmacovigilance est plus forte grâce au numérique, explique le Dr Petitpain. Quand on doit revenir vers le patient par exemple, le portail accélère la dynamique, notamment à travers la possibilité d’utiliser directement le mail pour les retours. Et puis on recueille un plus grand volume de déclarations, et c’est aussi un peu mieux organisé, même si plusieurs types de supports continuent à cohabiter – les personnes âgées utilisent encore la forme écrite. »
Une réalité qui évolue progressivement, à mesure que le monde de la santé prend conscience du bénéfice de l’analyse des traitements « en vraie vie ». « Les essais thérapeutiques randomisés permettent d’étudier le rapport bénéfice-risque d’un traitement dans l’absolu, mais le limitent à des populations ciblées, on ne l’essaie pas ‘comme il sera dans la vraie vie’, complète ainsi le Dr Marquet. La nouvelle pharmacovigilance s’appuie sur le numérique en permettant aux patients de déclarer directement un effet secondaire, sur le site internet de l’ANSM. Cela permet de détecter des signaux tout au long de la ‘vraie vie’ des médicaments et des dispositifs médicaux. Cette pratique vient en écho à la collecte des informations par les seuls professionnels de santé, telle qu’elle était pratiquée auparavant. »
Une révolution régulée par les pouvoirs publics
Mais comme toute révolution, celle-ci a connu sa part de soubresauts et de développements incontrôlés, avant d’être prise en main et régulée par les pouvoirs publics.
C’est notamment sur la question de la protection de la vie privée et des données à caractère personnel que ces derniers ont voulu mettre l’accent, notamment à travers un arrêté « fixant la liste des catégories d’événements sanitaires indésirables pour lesquels la déclaration ou le signalement peut s’effectuer au moyen du portail de signalement » (Arrêté du 17 février 2017), complété par la Délibération de la CNIL « portant adoption d’un référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre à des fins de gestion des vigilances sanitaires » (Délibération n° 2019-057 du 9 mai 2019).
Et la liberté de parole du patient, couplée à l’absence d’« encadrement » médical, génère aussi certains effets pervers, en particulier sur les réseaux sociaux. « On l’a vu sur les réseaux au moment de la crise du Levothyrox, les gens relayaient beaucoup de choses inexactes… s’inquiète le Dr PetitPain. Sur le portail, la crise a généré des retours pléthoriques, c’était plutôt contre-productif. Au milieu de vrais effets, il y avait un peu tout et n’importe quoi… Et comme le sujet était ultra-médiatisé, dans un contexte particulier, tout le monde s’est jeté dessus… »
Pour autant, du côté des laboratoires aussi, la révolution se fait à grandes enjambées. Face à des obligations liées à la pharmacovigilance (vérification de l’efficacité du médicament, surveillance des effets indésirables, etc.) de plus en plus complexes et de plus en plus lourdes à assumer, le numérique s’avère un allié extrêmement précieux. Un suivi attentif des groupes informels sur les réseaux sociaux et des forums de santé est par exemple mis en œuvre par plusieurs d’entre eux, avec l’aide de sociétés spécialisées dans le monitoring du web, afin d’identifier les « signaux faibles » autour d’une molécule ou d’un dispositif médical.
Blockchain et algorithme pour sécuriser et analyser
Parallèlement, des expérimentations autour de l’utilisation de la blockchain sont mises en place. En effet, la blockchain n’est pas réservée aux cryptomonnaies, mais s’adapte parfaitement à tout « objet » numérique – notamment à la « certification » de données de santé collectées « en vie réelle » auprès des patients[3]. C’est notamment le cas à travers le dispositif collaboratif « Embleema Health Network », qui rassemble plusieurs grands laboratoires à travers le monde pour analyser les informations issues de l’utilisation de leurs produits de santé[4].
Objectif : s’assurer – et assurer le public – que la collecte et l’exploitation de ces gigantesques masses de données ne donnent lieu à aucune torsion, à aucune falsification destinée à masquer les effets indésirables d’un produit de santé. L’affaire Levothyrox est passée par là. « Léonard de Vinci disait déjà que ‘la science la plus utile est celle dont le fruit est le plus aisément communicable’, note le Dr Marquet. La question, aujourd’hui, est la suivante : comment transforme-t-on cette masse de données en quelque chose de compréhensible ? Et la réponse, c’est un mot-clé : algorithme. On peut allier la puissance des ‘cerveaux mathématiques’ à la colossale et très variable masse de données qu’on sait désormais collecter, pour identifier et ordonner, de façon scientifique et rationnelle, ce qui est pertinent dans cette masse. »
Protéger la souveraineté des données médicales françaises
Du côté du secteur public, nous n’avons rien à envier sur le sujet des algorithmes et de la blockchain : le Health Data Hub, initié par le ministère des Solidarités et de la Santé en janvier 2018, déploiera plusieurs projets fondés sur leur utilisation. Il s’agit de promouvoir les projets destinés à analyser les données, les lier entre elles, et les rendre disponibles « afin de favoriser les études, recherches ou évaluations présentant un caractère d’intérêt public ».
Le numérique au service de la vigilance, encore. « Les Français sont plutôt en avance sur le sujet, se réjouit le Dr Marquet C’est encourageant pour la ‘souveraineté’ des données médicales françaises, notamment dans la mise en œuvre de traitements totalement anonymisés. » Une question centrale à l’heure où se multiplient les interrogations sur la dépendance sanitaire vis-à-vis de l’étranger…
Guetter les signaux faibles dans les maladies rares
L’actualité rattrape en effet aujourd’hui le train de la révolution numérique. L’utilisation de certaines molécules hors autorisation de mise sur le marché (AMM), qui se pose de façon aiguë dans la crise sanitaire du Covid-19 (notamment à propos de l’hydroxychloroquine), pose avant tout la question des effets liés aux interactions médicamenteuses et aux mésusages ou surdosages possibles de ces molécules.
Parallèlement aux études cliniques en cours, le rôle de la pharmacovigilance sera crucial dans l’adoption de certaines de ces molécules, et va probablement solliciter massivement les retours numériques des patients traités pour des formes légères du Covid-19. De la même façon qu’avant la crise, dans une urgence moins aiguë, la détection d’effets indésirables en pédiatrie ou en gériatrie, notamment, s’appuyait déjà largement sur la détection numérique. Ou dans le secteur des maladies rares, pour lesquelles « il est difficile de fixer une pharmacovigilance du fait d’une population de patients ultra resserrée, et où la détection de signaux à travers les réseaux sociaux est une des seules solutions auxquelles je crois », comme l’affirmait déjà le Dr Marquet il y a 3 ans[5].
Faire collaborer les associations de patients
Le retour à une situation stabilisée, dans quelques mois, devrait ouvrir un champ plus large que jamais à la pharmacovigilance numérique et à ses explorations profondes, dans tous les secteurs de la santé… Avec l’appui souhaitable des associations de patients. « Leur collaboration à l’écriture des plans de minimisation des risques est une excellente chose ! observe le Dr Marquet. Les associations représentant les patients diabétiques, par exemple, sont particulièrement vigilantes sur les dispositifs médicaux, d’autres le sont sur les traitements de fond, et cetera. La proximité avec les associations de patients permet de maintenir au premier plan la question du bon usage des produits de santé… et de la sécurité sociale ! »
« Le numérique est l’outil de notre temps, conclut le Dr Petitpain. Il faut le prendre en main, on doit notamment expliquer aux gens que déclarer un effet indésirable, ce n’est pas comme commander une paire de chaussures sur internet quand on connaît sa pointure. Pour le faire correctement, il faut des didacticiels, des aides, des bulles d’infos, des petits films – tout ce que nous avons mis dans la nouvelle version du portail… Et travailler avec les associations de patients. »
Ce que fait d’ores et déjà le réseau des CRPV, pour accompagner les patients dans une meilleure appréhension des outils numériques de déclaration.