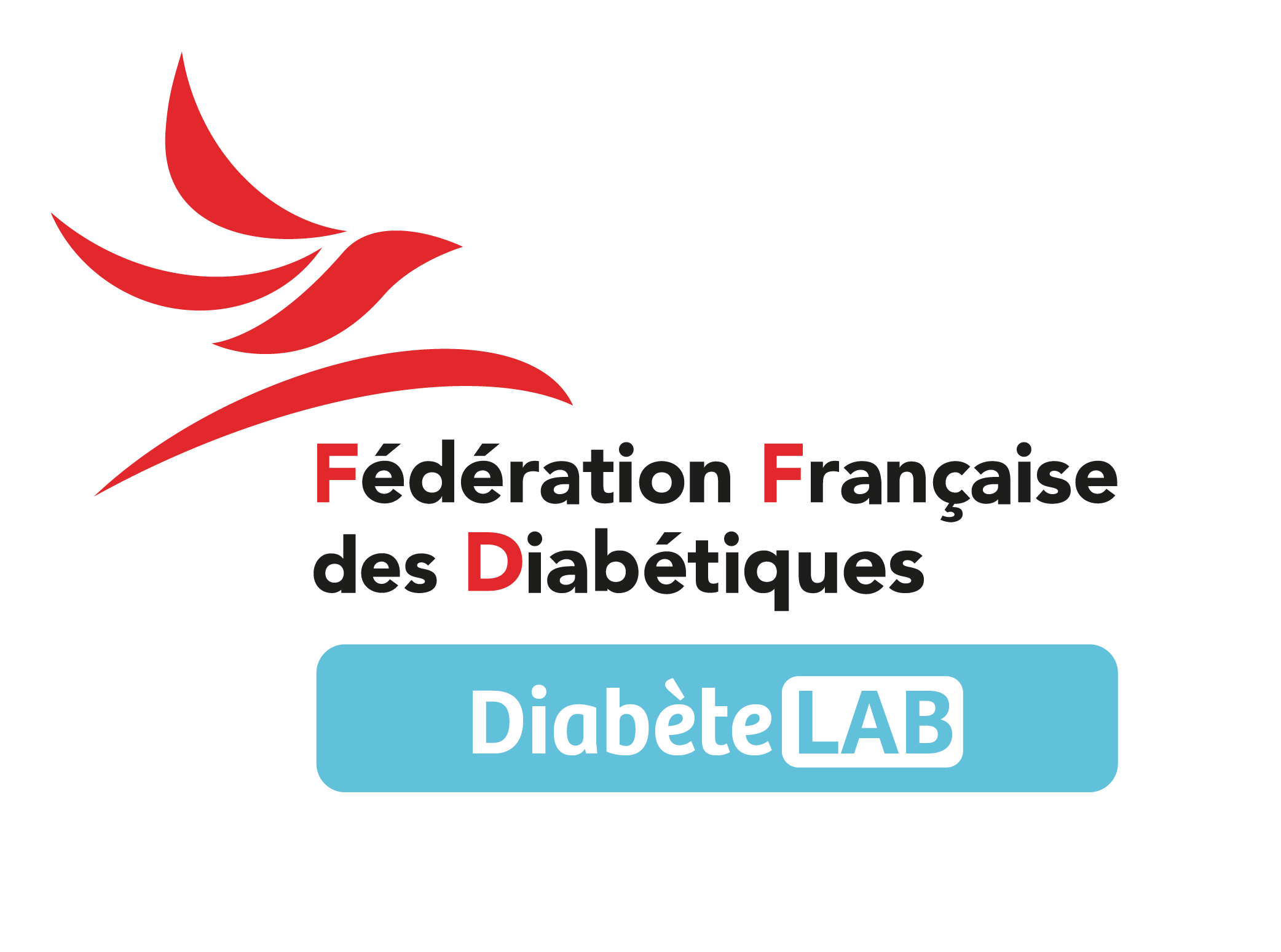Vous pensiez que les Prems ne pouvaient être autre chose que des billets de train, promesse de destinations de rêve à prix réduit ? Et les Proms, une série de concerts exceptionnels organisée chaque année par la BBC au Royal Albert Hall de Londres ? Eh bien vous allez découvrir aujourd’hui que sous ces délicieux acronymes réside aussi, dans l’univers de la santé, une réalité beaucoup plus prosaïque !
L’implication des patients, voulue par les lois santé de 2002, a bouleversé la façon dont est conduite aujourd’hui l’évaluation des systèmes de santé. Quels en sont les enjeux ? Le patient-expert créé par le législateur est-il la panacée ? Quel rôle peuvent jouer les associations de patients dans ces nouveaux dispositifs ?
Bruno Falissard et Julien Mousquès, spécialistes de l’évaluation et des statistiques en santé, ont bien voulu répondre à nos questions et nous apporter leur éclairage… d’expert !
PREMs et PROMs sont dans un bateau…
PREMs et PROMs sont deux indicateurs permettant d’évaluer la qualité des soins et, plus encore, tout ce qui les entoure, les rend possibles, plus ou moins performants, plus ou moins acceptables par le patient. Ils jouent ainsi un rôle croissant dans l’administration du monde de la santé, et plus récemment dans l’épidémiologie, la recherche clinique, le suivi des malades au quotidien, l’analyse des pratiques cliniques et des produits de santé…
Ces outils d’évaluation, issus comme leur nom l’indique du monde anglo-saxon, constituent en quelque sorte un « contrôle continu », puis un « examen final », réalisés directement par le patient ou appuyés sur des informations qu’il communique au système de santé :
- PREMs (Patient Reported Experience Measures) Mesures d’Expérience Rapportées par le Patient
- le patient évalue la manière dont il a vécu les soins qu’il a reçus.
- PROMs (Patient Reported Outcome Measures) Mesures de Résultat Rapportées par le Patient.
- le patient évalue son état de santé une fois l’épisode de soins terminé.
On ne peut pas dire qu’on met le patient au centre du système si on ne lui demande pas son avis !
Généralement mis en œuvre sous la forme de questionnaires plus ou moins denses, PROMs et PREMs améliorent sensiblement la relation soignant-patient, dans la mesure où ils permettent au second de s’exprimer assez librement, et au premier de mieux percevoir le ressenti de son patient. « Ces méthodes ont apporté un vrai changement, confirme Bruno Falissard. Dans l’asthme par exemple, les essais cliniques avaient autrefois comme seul critère la capacité à souffler dans un tuyau : ils portaient une conception exclusivement bio-physiologique de la maladie, sans prendre en considération le patient, et les médecins se rendaient bien compte que cela ne suffisait pas à évaluer l’amélioration du patient. Ils ont alors développé des PROMs pour s’intéresser à la qualité de vie globale de l’asthmatique, qui sont aujourd’hui aussi utilisées que les mesures de souffle pour évaluer l’asthme ! » Julien Mousquès résume d’une phrase ce changement d’approche : « On ne peut pas dire qu’on va mettre le patient au centre du système si on ne lui demande pas son avis ! »
Franc succès dans les années 90 et jusqu’au début du 21e siècle, PREMs et PROMs touchent alors à leurs limites, notamment anthropologiques. Ces mesures sont évidemment dépendantes de la culture des populations qui les mettent en œuvre. Or « la langue et la culture dominantes sont celles des chercheurs anglo-américains : la diffusion de leurs approches se fait facilement, mais c’est un problème pour le maintien ou le développement d’outils créés dans des cultures non dominantes », explique Bruno Falissard.
Les mesures réalisées étant éminemment subjectives (« le patient est sollicité ici en tant que sujet pensant, et non en tant que corps atteint », dit Bruno Falissard), elles sont elles aussi soumises à variabilité culturelle : « Pour les Français, la parole du clinicien est importante pour aider le patient à dire ce qu’il pense, poursuit-il. Alors que pour les Américains, le patient dit toujours ce qu’il pense réellement, alors que c’est loin d’être toujours vrai… » Les risques de biais d’interprétation augmentent donc proportionnellement à la diffusion de ces techniques, et finissent par en rendre l’utilisation problématique.
Avec 20 heures de psycho, les soignants ne sont pas formés à recevoir l’irrationnel…
C’est dans ce contexte que la loi sur le droit des patients, en 2002, permet de franchir un nouveau pas décisif dans l’implication de ces derniers. « Le sida a marqué l’entrée des associations de patients dans l’évaluation du système de santé, note Julien Mousquès. Le système de santé était le dernier à ne pas intégrer le « consommateur » comme un centre, alors que c’était une attente portée par la société. La loi a apporté un changement de position du politique et de l’institution, réelle, non feinte, à travers la mise en œuvre de dispositifs d’implication des associations », notamment celles qui ont mis en place des outils de recueil de la parole des patients, comme le Diabète LAB pour la Fédération Française des Diabétiques…
Ces dispositifs se mettent toutefois en place au rythme de l’institution médicale. « Les patients sont globalement embarqués dans cette histoire de façon systémique, lente, ça se fait sans qu’ils s’en rendent compte, presque à leur insu. Chacun reste près de son idéologie, les médecins se protègent derrière une pensée biologique, les patients se protègent avec ce qu’ils peuvent, c’est-à-dire souvent en allant sur internet et devenant acteurs de leur maladie, en étant plus exigeant avec les soignants, et aussi avec de l’irrationnel – les soins non conventionnels », prolonge Bruno Falissard. Et le problème, c’est que les soignants ne sont pas formés à recevoir cet irrationnel, notamment lorsqu’il surgit… au détour d’un PROM : « il y a 600 heures de biologie pour 20 heures de psycho dans le cycle X des études de médecine ! » s’exclame-t-il.
Le « patient-expert », une solution miracle ?
La solution miracle résiderait-elle dans la création du « patient expert », tel qu’il est pensé par la loi de 2002 ? Officiellement impliqués dans la gouvernance des établissements de santé, les patients ont désormais voix au chapitre, et pas seulement au sujet de leur propre maladie, mais pour évaluer l’ensemble du dispositif de soins. Au risque, formation aidant, de devenir un « quasi professionnel de santé » ; et de sortir de sa « naïveté » de patient, de sa posture initiale, et parfois de son intégrité ? En effet, ainsi conduit à devenir en quelque sorte juge et partie, il en viendrait à acquérir un pouvoir « supérieur » dont rien ne permet de penser qu’il userait de façon systématiquement juste, avec recul et sens de la discrimination… Pourtant, « la principale difficulté ne réside pas là, tempère Bruno Falissard. Le problème, c’est l’exposition médiatique du patient-expert. Il devient une star parce qu’il est un « bon client », il parle bien en public, il est utile… Et ce n’est pas facile de gérer un succès médiatique. » Pour le psychiatre, une fois encore « c’est aux associations de réguler, de dire « on se reconnaît » ou pas dans ce que dit chaque patient-expert. »
Pratiquer la médecine, c’est faire un effort d’écoute !
Pour autant, la position du patient-expert s’affine avec le temps, et certains apportent réellement à l’évaluation des pratiques, allant parfois jusqu’à faire évoluer la parole des scientifiques en les bousculant avec le vécu des patients… « Tous les médecins apprennent de l’expression des patients : quand on étudie la médecine, on a besoin de se fermer un peu, parce que c’est long et compliqué, mais lorsqu’on pratique il faut faire un effort d’écoute, on apprend autre chose, autrement, à partir d’une autre source – les patients… », constate Bruno Falissard.
Dans ce contexte nouveau et en évolution continue, comment alors envisager les nouvelles formes d’évaluation du système de santé par les patients ? Les acteurs « intermédiaires » comme les associations de patients ont selon Julien Mousquès de multiples vertus, et un rôle majeur à jouer sur plusieurs « couches » de l’évaluation des systèmes de santé.
« Les associations – et leurs laboratoires comme le Diabète LAB – doivent participer au développement d’outils méthodologiques croisant « quali » et « quanti », pour aboutir à des recueils de données pertinents (tests, focus groupes, construction de questionnaires, etc.) ; ils peuvent aider sur des aspect d’implémentation de ces outils (comment avoir les bons réflexes méthodologiques pour obtenir les bons taux de réponse, etc.) ; enfin ils peuvent apporter leur expertise de l’analyse et de l’interprétation, afin que ces dernières ne soient pas laissées dans les mains de tiers mais impliquent des acteurs capables de faire levier sur l’amélioration du système », explique-t-il.
Croiser les études qualitatives et les technologies de traitement automatique du langage ?
Etudes qualitatives provoquant la parole, mais aussi traitement automatique du langage sur les forums numériques, par exemple pour faire émerger les plaintes, les attentes, les désirs des patients… De nombreuses startups explorent désormais cette voie. « Ce n’est pas gênant, analyse Bruno Falissard. C’est un tout petit business par rapport à celui du médicament ! Il faut simplement brider leur tendance technophile et remettre de l’humain dans leurs process, ne pas chercher à remplacer les entretiens en face à face avec les patients, utiliser l’intelligence artificielle pour mieux extraire les éléments saillants ou identifier les signaux faibles… »
Aucune méthode d’évaluation et d’implication du patient ne pouvant posséder toutes les vertus, il convient alors de développer une approche « suffisamment bonne », pour reprendre les mots de Donald Winnicott. « L’essentiel est de croiser les différents outils de mesure disponibles, conclut Julien Mousquès. Les outils objectifs (la mesure de l’espérance de vie sans incapacité, par exemple ; les mesures issues des dispositifs médico-administratifs (les données de l’assurance maladie) ; et les retours subjectifs (les avis portés par les patients, de type Prems/Proms). » Une combinatoire vertueuse, selon lui, qui permet d’obtenir dans le même mouvement « des résultats utiles à la fois pour les patients et pour les acteurs qui organisent, financent et délivrent des soins ».
Bruno Falissard est pédopsychiatre et biostatisticien, Professeur de Santé Publique à la Faculté de Médecine de l’Université Paris XI et Directeur de l’Unité Inserm 1178. Il est spécialiste de l’évaluation des thérapeutiques – il travaille particulièrement au développement de méthodes statistiques appliquées aux mesures « subjectives » (dépression, fatigue, qualité de vie…).
Julien Mousquès est biostatisticien, Directeur de Recherche à l’Institut de Recherche et de Documentation en Economie de la Santé (IRDES) à Paris et Visiting Scientist au Department of Health Care Policy de la Harvard Medical School à Boston (USA). Il travaille notamment sur les questions d’évaluation des systèmes de santé.