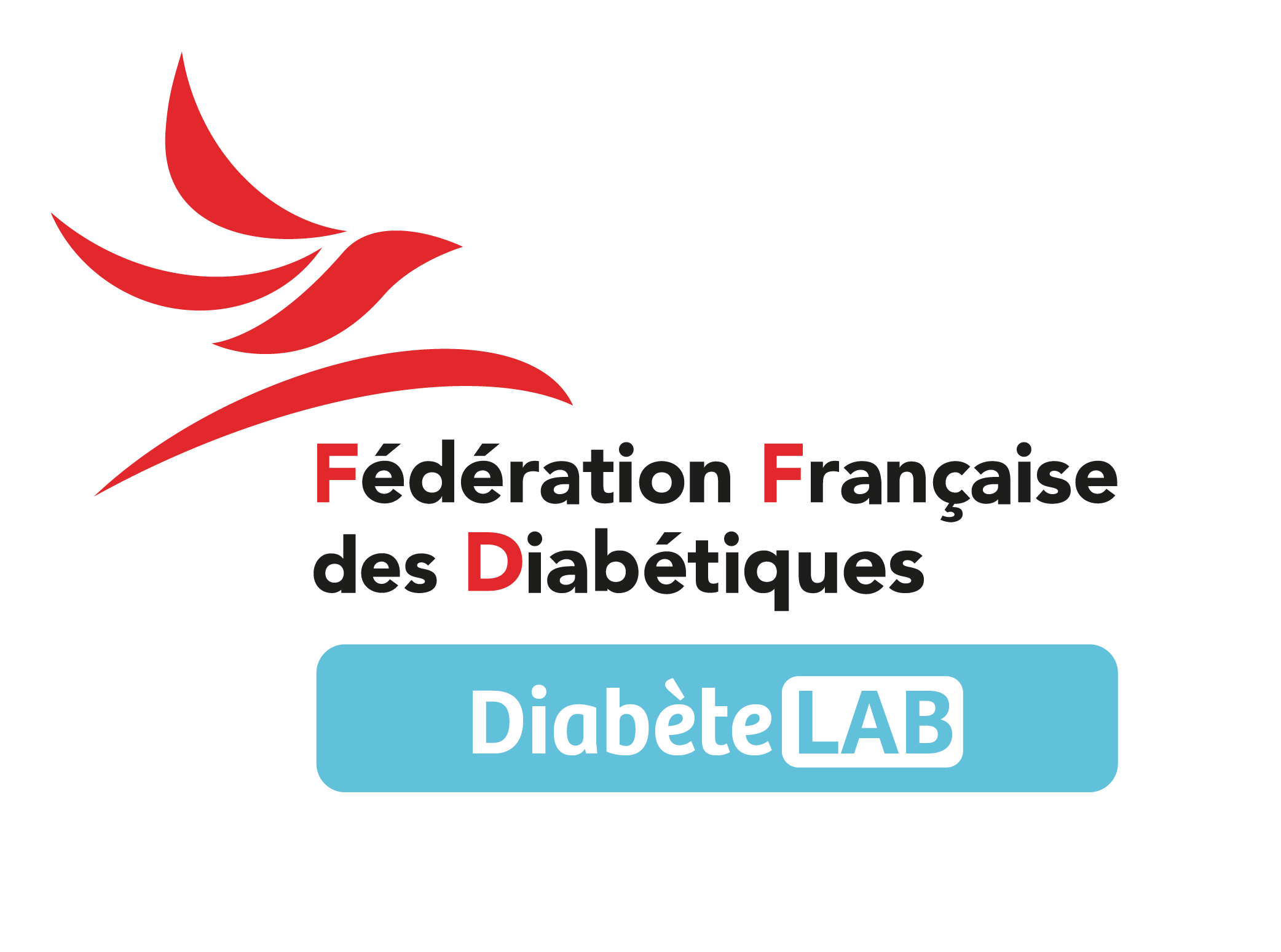MEMO - COMPRENDRE LES INSTITUTIONS DE SANTÉ
L’organisation de la santé en France est parfois compliquée à décoder. Et pour les patients, identifier le bon interlocuteur pour un besoin précis peut ressembler à un parcours du combattant…
Vous peinez à vous orienter parmi les acteurs de la santé publique ? Vous ne savez pas à qui vous adresser ? Vous voudriez simplement comprendre comment fonctionnent ces institutions ? Voici un Mémo, guide non exhaustif – les associations de patients, par exemple, n’y figurent pas – pour ne plus se perdre dans le dédale des institutions de santé !
LES ACTEURS NATIONAUX
Le plus haut échelon du système de santé français est national : ce sont les services du ministère et les agences et instituts nationaux.
CE QU'ILS FONT
✅ Décident des politiques de santé publique
✅ Organisent l’offre sanitaire sur le territoire
QUI ILS SONT ?
Les directions sanitaires du ministère des solidarités et de la santé
✅ Direction générale de la santé (DGS) :
- prépare la politique de santé publique.
✅ Direction générale de l’offre de soins (DGOS) :
- conçoit et organise l’offre de soins et gère les ressources sanitaires.
Une des directions sociales du ministère des solidarités et de la santé
✅ Direction de la sécurité sociale (DSS) :
- met en œuvre la politique de solidarité sociale (assurance maladie, dépendance, etc.).
Les autorités de santé
✅ Haut conseil de la santé publique (HCSP) :
- organisme consultatif qui propose des objectifs pluriannuels de santé publique.
✅ Haute autorité de santé (HAS) :
- autorité indépendante
- édicte les bonnes pratiques en matière d’évaluation des soins, de remboursement, de certification des établissements, d’accréditation des professionnels de santé…
Les établissements publics (quelques exemples)
✅ Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) :
- évalue les produits de santé et les dispositifs médicaux avant leur autorisation de mise sur le marché
- assure et centralise la collecte des signalements d’effets indésirables.
✅ Etablissement français du sang (EFS) :
- collecte et distribue les produits sanguins instables.
✅ Santé publique France (SPF) :
- veille sur les risques sanitaires
- assure la promotion de la santé, la prévention et l’éducation pour la santé.
Les instituts et autres établissements publics
✅ Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) :
- coordonne la recherche médicale et biologique.
POURQUOI LES CONTACTER ?
Vous n’avez a priori aucune raison de contacter ces instances nationales. Elles ne répondent pas directement aux requêtes du grand public, en dehors de certains établissements particuliers :
✅ l’EFS pour donner votre sang et/ou vos plaquettes ou transmettre une information en cas d’infection constatée dans les 15 jours après un don
✅ l’ANSM pour déclarer un événement indésirable lié à un médicament ou à un dispositif médical.
Pour les autres, ce sont les acteurs locaux qui assurent le relais avec la population.
COMMENT LES CONTACTER ?
LES ACTEURS RÉGIONAUX
Les services régionaux de santé ont été complètement rénovés en 2010.
Cet échelon constitue désormais le principal organisateur de la « médecine de parcours » – c’est-à-dire l’organisation des soins autour du médecin traitant, qui pilote le « parcours » du patient en l’orientant vers les spécialistes et/ou les services hospitaliers qu’il estime utile de consulter…
CE QU'ILS FONT
✅ Adaptent la politique nationale de santé publique aux caractéristiques régionales des populations (épidémiologie, démographie, géographie…)
✅ Mettent en œuvre les programmes régionaux de santé (PRS) qui en sont issus
✅ Coordonnent l’action des établissements de santé publics et privés
✅ Organisent les soins dans le cadre de la médecine de parcours « de ville » (professionnels libéraux), à travers les schémas régionaux d’organisation des soins (SROS)
✅ Assurent la veille et la sécurité sanitaire sur le territoire
✅ Assurent un relais de proximité pour favoriser les questions d’effets indésirables
✅ Assurent les échanges de proximité entre associations de patients et professionnels de santé
✅ Organisent l’inclusion sociale des personnes handicapées
✅ Assurent la formation des professions de santé non médicales : infirmier(e)s et puériculteur(trice), auxiliaire de puériculture, aide-soignant(e), ambulancier(e), ergothérapeute, kinésithérapeute, cadre de santé…
QUI ILS SONT ?
Les agences régionales de santé (ARS)
Intègrent et reprennent les missions (voir ci-dessus) des structures qu’elles ont remplacées, notamment :
✅ Directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales (DRAS et DDAS)
✅ Groupements régionaux de santé publique (GRSP)
✅ Missions régionales de santé
✅ Pôle santé des caisses régionales d’assurance maladie (CRAM).
Les centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV)
31 centres répartis sur le territoire pour favoriser le suivi des signalements d’effets indésirables.
Les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) :
En matière de santé, pilotent la lutte contre les exclusions – notamment des personnes handicapées et des personnes fragiles – et contre les discriminations.
POURQUOI LES CONTACTER ?
✅ A l’échelon régional, vous pourrez consulter le site internet de votre ARS :
- pour trouver un professionnel de santé dans votre secteur
- pour prendre connaissance des données de santé et de la politique de santé de votre Région
✅ Vous pourrez contacter votre CRPV :
- lorsque vous avez besoin de déclarer un effet indésirable d’un médicament, d’un traitement ou d’un dispositif médical, et que vous ne souhaitez pas déclarer sur la plateforme numérique de l’ANSM
- lorsque vous avez besoin d’informations générales sur l’offre de soins dans votre région, notamment dans une spécialité particulière.
COMMENT LES CONTACTER ?
✅ Portail des ARS : https://www.ars.sante.fr/
✅ Adresses e-mail et numéros de téléphone des 31 CRPV : https://www.ansm.sante.fr/Declarer-un-effet-indesirable/Pharmacovigilance/Centres-regionaux-de-pharmacovigilance/
LES ACTEURS LOCAUX
En France, les institutions de santé disposent de très nombreux relais de proximité, au contact du public.
Les acteurs de l’offre de soins, eux aussi, sont des acteurs locaux installés au plus près des usagers. L’évolution du système de soins et son organisation en réseau rapprochent encore plus les soins des patients.
CE QU'ILS FONT
✅ Assurent les soins « primaires » – dits « de proximité » ou « de premier recours » (généralistes)
✅ Assurent la continuité du parcours de santé à travers les soins « de second recours » (spécialistes) et « de troisième recours » (hôpital)
✅ Assurent un traitement adapté de questions sanitaires spécifiques
✅ Proposent des alternatives nouvelles à l’hospitalisation classique :
- chirurgie ambulatoire
- télémédecine (téléconsultation, télé-expertise, télésurveillance, téléassistance, régulation médicale)
- hospitalisation à domicile
- soins infirmiers à domicile
- accueil temporaire en EHPAD
✅ Forment les professionnels de santé médicaux (médecins)
✅ Assument en grande partie la charge de la recherche médicale.
QUI ILS SONT ?
Les cabinets médicaux privés de ville (généralistes et spécialistes)
Les centres d’exercice collectif
✅ Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP)
✅ Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS)
Les consultations privées de spécialistes en milieu hospitalier
Les centres hospitaliers
✅ Hôpitaux publics
✅ Cliniques privées à but lucratif
✅ Etablissements privés d’intérêt collectif (centres de dialyse, centre anti-cancer…)
Les établissements médico-sociaux
✅ Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
✅ Structures pour personnes handicapées
Les centres et consultations dédiés à des questions spécifiques :
✅ Consultations spécialisées douleur
✅ Consultations mémoire
✅ Centres spécialisés pour les patients obèses
✅ Centres de références maladies rares
✅ Maisons départementales pour personnes handicapées (MDPH)
✅ Maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer (MAIA)
POURQUOI LES CONTACTER ?
Vous contactez les acteurs de la santé de proximité lorsque vous avez besoin de soins, pour une pathologie aigue ou chronique, ou pour consulter lorsque vous avez un doute sur votre état de santé.
COMMENT LES CONTACTER ?



LES URGENCES
CE QU'ILS FONT
✅ Répondent aux besoins de santé qui ne peuvent pas attendre un rendez-vous ou qui n’étaient pas prévisibles
✅ Prennent en charge de façon immédiate les accidentés et les malades, victimes d’affections soudaines, se trouvant « en état critique »
✅ Accueillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
QUI ILS SONT ?
SAMU, SMUR, SDIS : les urgences « pré-hospitalières »
✅ Service d’aide médicale urgente (SAMU) :
- appelé aussi « Centre 15 »
- central téléphonique équipé d’un « médecin régulateur »
- assure la répartition des demandes d’assistance vers les ressources médicales d’urgence disponibles.
✅ Structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) :
- service d’urgence hospitalière mobile
- constitué d’ambulances équipées de matériel de réanimation et d’un médecin
- « prolonge » et projette vers l’extérieur l’action des urgences hospitalières.
✅ Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) :
- service d’urgence mobile des pompiers, dit de « prompt-secours » ou « premier secours » (PS)
- assure à la demande des Centres 15 les premiers secours aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation vers un service d’urgences hospitalières.
Les urgences hospitalières
✅ Services d’urgences générales des hôpitaux, incluant a minima :
- des médecins urgentistes et personnels de santé formés aux urgences
- deux salles d’opération et une salle de réveil
- une unité de réanimation
- une unité de déchocage
✅ Services d’urgences pédiatriques des hôpitaux, incluant a minima :
- les mêmes personnels et matériels que les urgences générales
- des personnels et du matériel dédiés à la réanimation pédiatrique.
POURQUOI LES CONTACTER ?
✅ Le SAMU : vous appelez parce que vous êtes en situation d’urgence vitale : accident, aggravation brutale d’une affection…
✅ Les urgences hospitalières : vous n’avez pas besoin de prendre contact préalablement, c’est le principe même des urgences ; vous vous y rendez directement si vous êtes dans une situation médicale qui doit être prise en charge rapidement, sans être critique.
COMMENT LES CONTACTER ?
✅ Le 15 : n° de centralisation de l’aide médicale d’urgence pour la France.
✅ Le 112 : n° unique pour toute l’Europe depuis 2008 (fonctionne aussi en France). Accessible depuis tous les téléphones (même sans carte SIM ou sans crédit) ou des cabines téléphoniques (sans carte téléphonique).
Téléchargez et imprimez la version papier de ce mémo !
Elle vous permet de conserver avec vous ou d’afficher nos explications et nos conseils.
Les Mémos du Diabète LAB vous aident à vous souvenir des points essentiels concernant un aspect particulier de votre diabète.
Chaque Mémo est différent, dans sa structure et sa forme, pour rester aussi clair et efficace que possible.
Un Mémo rassemble quelques pistes pour comprendre, ainsi que des conseils génériques. Il ne remplace en aucun cas la consultation chez votre médecin. S’il suscite des questions, vous pouvez l’imprimer et le montrer à votre médecin traitant ou à votre diabétologue.