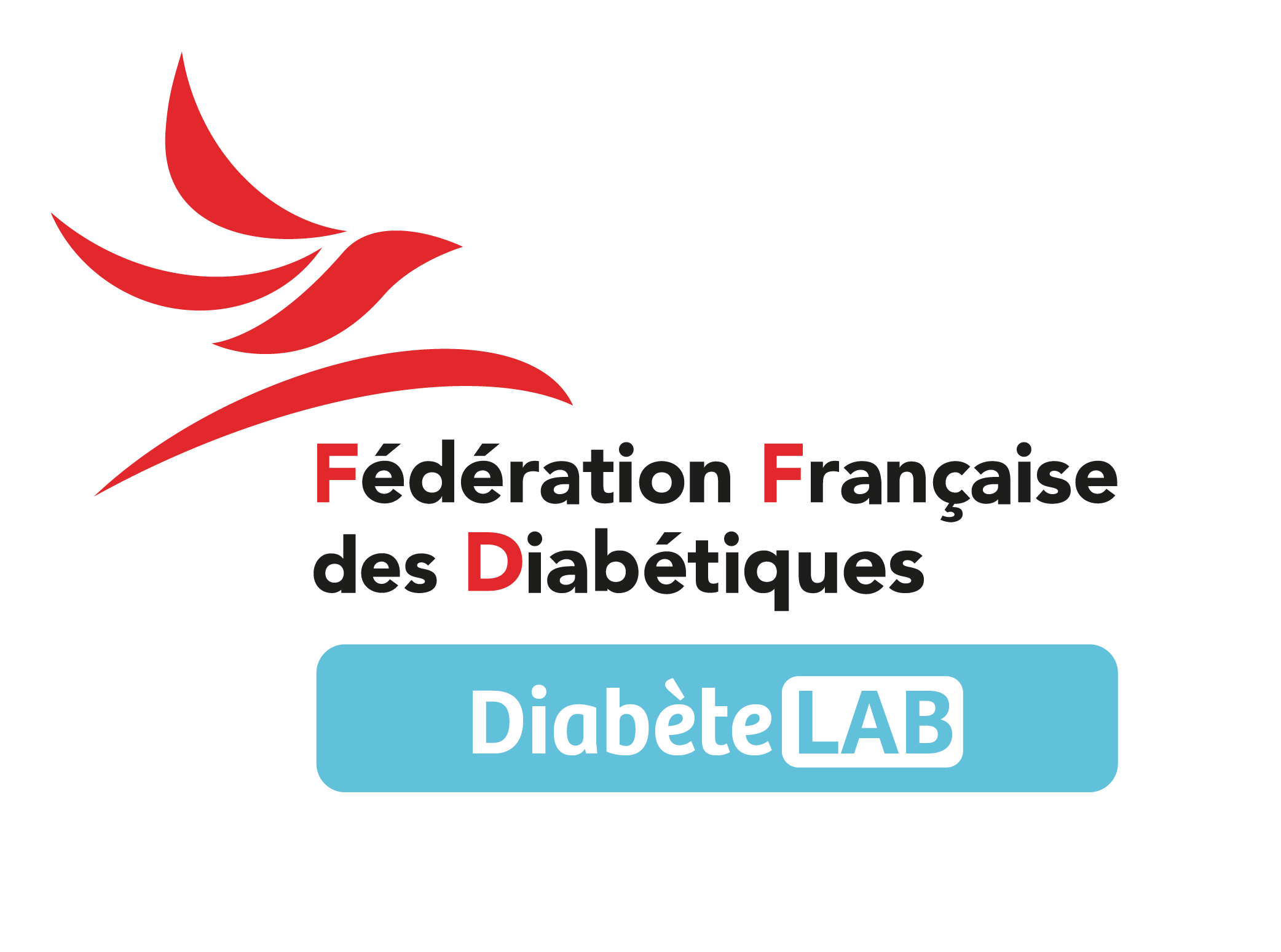Autrice : Marie Barroyer, doctorante en sociologie
Cet article repose sur une recherche doctorale réalisée par Marie Barroyer, doctorante en sociologie travaillant au Diabète LAB. et au Laboratoire de Sociologie TETRAS situé à Nancy. En début d’année, elle a conduit une enquête de terrain dans trois EHPADs différents dans le but de saisir comment les résidents vivaient avec leur diabète dans ces établissements. La recherche montre que chaque établissement fonctionne différemment, et que ces différences ont une influence sur la manière dont le diabète est géré à la fois par les résidents, et par les professionnels. Ce constat fait écho à des situations remontées concomitamment à la Fédération, via notamment le service juridique qui a mis en lumière des disparités relatives à l’usage et la prise en charge financière des capteurs de glycémie en EHPAD.
Les premiers capteurs de mesure continue du glucose sont apparus au début des années 2000. Cependant, leur diffusion à plus grande échelle ne s’est véritablement opérée qu’une dizaine d’années plus tard, entre 2006 et 2008, avec l’arrivée des premiers dispositifs de suivi en temps réel. C’est surtout à partir de 2014, avec le lancement du FreeStyle Libre, puis son remboursement en 2017, que l’équipement s’est fortement accéléré. Avant cette date, ces capteurs restaient coûteux et donc peu accessibles pour la plupart des personnes atteintes de diabète. Depuis, de nouvelles générations de capteurs ont vu le jour – FreeStyle Libre 2, FreeStyle Libre 3, Dexcom One, Dexcom One+– transformant profondément le « travail de malade ». Ces dispositifs ont en effet allégé les contraintes du suivi glycémique, en remplaçant les mesures par capillarité, nécessitant une piqûre au bout du doigt, par une surveillance en continu et moins invasive. À priori, ces dispositifs s’adressent à toutes les personnes atteintes de diabète, quel que soit leur âge.
En 2023, on estimait qu’en France, une personne atteinte de diabète sur quatre avait plus de 75 ans, tout type confondu (Bauduceau & Doucet, 2023). Ainsi, de plus en plus de personnes vieillissent avec leur diabète, mais aussi avec leurs capteurs, qui accompagnent désormais leur quotidien et leurs pratiques de soin, et ceci notamment dans des environnements spécifiques tels que les EHPADs.
Trois établissements, trois situations différentes vis-à-vis de la prise en soin du diabète.
Les trois EHPADs étudiés dans le travail d’enquête de Marie présentaient des situations différentes vis-à-vis de la place du diabète et des capteurs de glycémie. Dans le premier, six résidents étaient atteints de diabète au moment de l’enquête, dont deux équipés de capteurs. Ces derniers étaient insulino-dépendants, contrairement aux autres, tous atteints de diabète de type 2. Dans le second EHPAD, sept personnes présentaient un diabète ; quatre étaient traitées par insuline, mais aucune n’était équipée de capteur. Enfin, dans le troisième établissement, on recensait également sept résidents atteints d’un diabète, dont trois sous insuline ; deux d’entre eux utilisaient un capteur de glucose.
Les établissements enquêtés relevaient tous du secteur public. Le diabète implique un ensemble de compétences, d’apprentissages, d’actes à réaliser pour gérer la maladie, dont l’intensité dépend des dispositifs mobilisés pour sa gestion ainsi que des contextes environnementaux dans lesquels les personnes se trouvent. En effet, l’EHPAD a été présenté par deux infirmières interrogées comme un lieu pris entre différentes contraintes : lieu de vie, lieu de soin mais aussi lieu de fin de vie. Ces tensions viennent reconfigurer la prise en charge du diabète, et les exigences des professionnels de santé.
« Les objectifs glycémiques sont beaucoup moins stricts que pour une personne jeune, protéger les artères, éviter les problèmes de rétinopathie, éviter les problèmes rénaux, tout ce qui découle du diabète. Chez les personnes âgées (…) C’est… ne pas se focaliser sur leur diabète, sur… Laissons-leur profiter des quelques années qui leur restent (…) Ce n’est pas la peine de vouloir avoir des objectifs stricts qui ne serviront à rien, si ce n’est à les embêter, à les… il faut leur laisser leur petit plaisir. » Infirmière avec 27 ans d’expérience en EHPAD
La fin de vie, envisagée par les soignants, à travers une espérance de vie supposée réduite pour les résidents, conduit à un relâchement des exigences thérapeutiques et à une forme de démédicalisation du diabète, ce qui amène les professionnels de santé à assouplir la surveillance glycémique. Cette logique est sous-tendue par l’idée que, compte tenu d’un temps de vie restreint, les conséquences physiologiques de l’hyperglycémie n’auront pas le temps de se manifester.
Des logiques budgétaires différente
Ainsi, il apparait que l’entrée en EHPAD reconfigure profondément la gestion du diabète. Or, ces reconfigurations apparaissent fortement dépendantes du degré de médicalisation du diabète qui relève d’un choix de l’équipe soignante, et des logiques d’équipements propres à chaque établissement. En portant la focale sur le travail d’équipement (Nguyen-Vaillant, 2010) et en prenant pour cas d’étude les lecteurs de glucose en continu, il devient possible d’analyser les logiques institutionnelles et professionnelles qui façonnent leur maintien, leur mise en place ou leur retrait au sein des structures d’hébergement.
En institution, le capteur est à la charge de l’établissement. Dans le premier établissement étudié, les résidents atteints d’un diabète de type 2 et bénéficiant d’au moins une injection d’insuline par jour sont systématiquement équipés de capteurs dès leur arrivée, permettant de faciliter le travail des soignants. Au contraire, dans les autres établissements, le capteur peut être retiré dès l’arrivée en institution. Ce fut le cas pour une résidente de 89 ans, vivant à l’EHPAD depuis 4 mois, ayant un diabète de type 2. Son capteur lui a été retiré pour être remplacer par la surveillance avec glycémie capillaire, un acte plus douloureux, contraignant pour la personne et pour les soignants. Cette position est explicitement formulée par l’infirmière :
« Elle est arrivée avec un capteur, mais étant donné que l’on ne surveille… la… la glycémie qu’une fois par jour… euh… les capteurs coûtent très cher. C’est payé par l’EHPAD, donc on ne va pas… euh… payer pour rien. »
Le retrait des capteurs est justifié par une contrainte budgétaire. Ce type de décisions révèle notamment de logiques de rationalisation managériale (Jacquot, 2016), où le coût de l’équipement devient un critère de médicalisation ou de démédicalisation. Des contraintes dans les modes de financements peuvent expliquer les choix réalisés par les EHPADs. Dans le premier établissement, la dotation pratiquée offre une plus grande souplesse budgétaire, facilitant l’achat d’équipements, tandis que la dotation pratiquée dans les autres restreint ces marges de manœuvre. Au-delà des seules questions financières et budgétaires, le profil du directeur du premier EHPAD, un ancien infirmier ayant lui-même exercé en institution peut participer à expliciter ces choix.
Des représentations des vieillissements et du soin
L’environnement influe ainsi directement sur les modalités d’équipement et les surveillances du diabète, et des configurations différentes entre sous culture d’établissement engendrent des formes variées de médicalisation. De plus, le risque de représentations âgistes, c’est-à-dire des stigmates associés aux personnes âgées, peuvent jouer également un rôle central dans ces pratiques. Du point de vue des soignants, l’idée selon laquelle il ne serait plus « utile » d’équiper des personnes très âgées contribue à expliquer le faible recours à ces dispositifs.
Dans le cas d’une résidente équipée d’un capteur, il apparait que cet équipement lui confère un moyen de renforcer sa surveillance alimentaire, et permet à l’institution de fabriquer des formes d’alliances thérapeutiques. Cette résidente a l’autorisation de conserver son lecteur pour contrôler sa glycémie alors que cela n’est pas le cas pour tous. Son contrôle du diabète vient configurer des formes de prises, de contrôle sur son vieillissement à la fois social (en montrant qu’elle gère son diabète pour échapper aux stigmates de la vieillesse) et physiologique (éviter que le diabète n’abîme le corps).
Dans le cas d’un résident de 98 ans, polypathologique, atteint d’un diabète de type 2, le contrôle de la glycémie est réalisé par les infirmières. Dans son cas, les problèmes de santé – problèmes de vision et la polypathologie – participent à son absence de contrôle sur la gestion de son diabète et contribuent à renforcer l’image d’un résident grabataire. Il est à noter que ce dernier n’a jamais réellement eu prise sur son diabète au sens d’une gestion personnelle de son traitement. Comme un certain nombre d’hommes de son âge et de son milieu social -issu de classe populaire-, la gestion de la santé est souvent déléguée aux femmes. Ainsi, les logiques de médicalisation ne reposent pas seulement sur le capteur mais également sur les pratiques qui l’accompagnent, et l’environnement dans lequel évoluent les personnes atteintes de diabète.
Les décisions prises par les EPHAD relèvent de certains contextes et de choix pour leur gestion des soins, qui sont à la fois guidés par des critères médicaux, mais aussi par des contraintes budgétaires. Pour les résidents, ces décisions entraînent des conséquences très concrètes sur leur état de santé, leur confort et leur autonomie vis-à-vis du diabète, qui lorsqu’il est mal équilibré peut avoir de graves conséquences même sur le court terme.
Conclusion
Cette recherche doctorale, menée dans le cadre d’une thèse CIFRE en partenariat avec la Fédération Française des Diabétiques et l’Université de Lorraine, a permis d’enrichir les réflexions internes à la Fédération autour de la prise en charge du diabète en EHPAD. Les données issues de la recherche, croisées avec les remontées des patients via la ligne téléphonique d’écoute Écoute Solidaire, de la Fédération ont contribué à rendre visibles des problématiques concrètes liées à l’accès et à l’usage des capteurs de glucose en continu en institution. Ces résultats ont conduit à une prise de parole publique, notamment à travers un article de presse publiée le 21 août 2025 par la Fédération.
Cette médiatisation, issue de la thèse, du travail de la Fédération et de la mobilisation des patients, a mis en lumière ces enjeux. Mais cette visibilité a également montré comment différents acteurs, dont des fabricants de dispositifs médicaux , s’emparent de la question selon leurs logiques propres. Chacun appréhende la question à partir de sa perception. Pour une entreprise privée qui commercialise des capteurs de glycémie, l’enjeu concerne la place, l’usage et la diffusion de ces capteurs dans les EHPADs. Pour la Fédération, la priorité reste l’amélioration du quotidien et des droits des personnes vivant avec un diabète, et l’égalité pour l’accès aux dispositifs médicaux améliorant cette qualité de vie. Pour la sociologue, cette situation soulève des questionnements, le travail de recherche ne vise pas à promouvoir une technologie ni à soutenir une stratégie industrielle, mais à analyser les expériences vécues du diabète au fil du vieillissement et à mieux saisir leurs spécificités.
Cependant, être engagée dans une thèse au sein d’une association de patients, confronte inévitablement la recherche à des zones de tension, entre production de savoirs, enjeux économiques, et amélioration du quotidien des personnes atteintes d’un diabète. Ces approches se croisent, tout de même, dans un même objectif, mieux saisir et améliorer les vécus des personnes ayant un diabète.
Bibliographie indicative
BAUDUCEAU, Bernard & DOUCET, Jean. (2023). Introduction : la prise en charge des personnes âgées vivant avec un diabète, une question d’actualité et d’avenir. Médecine des Maladies Métaboliques, vol. 17, no 8, pp. 1-2.
CHAMAHIAN, Aline & CARADEC, Vincent. (2014). Vivre « avec » la maladie d’Alzheimer : des expériences en rupture avec les représentations usuelles de la maladie. Retraite et Société, vol. 69, no 3, pp. 17-37. https://doi.org/10.3917/rs.069.0017
JACQUOT, Lionel. (2016). Travail, gouvernementalité managériale et néolibéralisme, Paris / L’Harmattan.
MAUSS, Marcel. (1950). Les techniques du corps. In : MAUSS, Marcel, Sociologie et anthropologie, Paris : PUF.
NGUYEN-VAILLANT, Marie-France. (2010). Le carnet de surveillance dans le diabète. Revue d’anthropologie des connaissances, vol. 4, no 1, article 1. https://doi.org/10.3917/rac.010.0380
TOURETTE-TURGIS, Catherine & THIEVENAZ, Joris. (2013). La reconnaissance du « travail » des malades : un enjeu pour le champ de l’éducation et de la formation. Sciences de l’éducation, pp. 69-87.