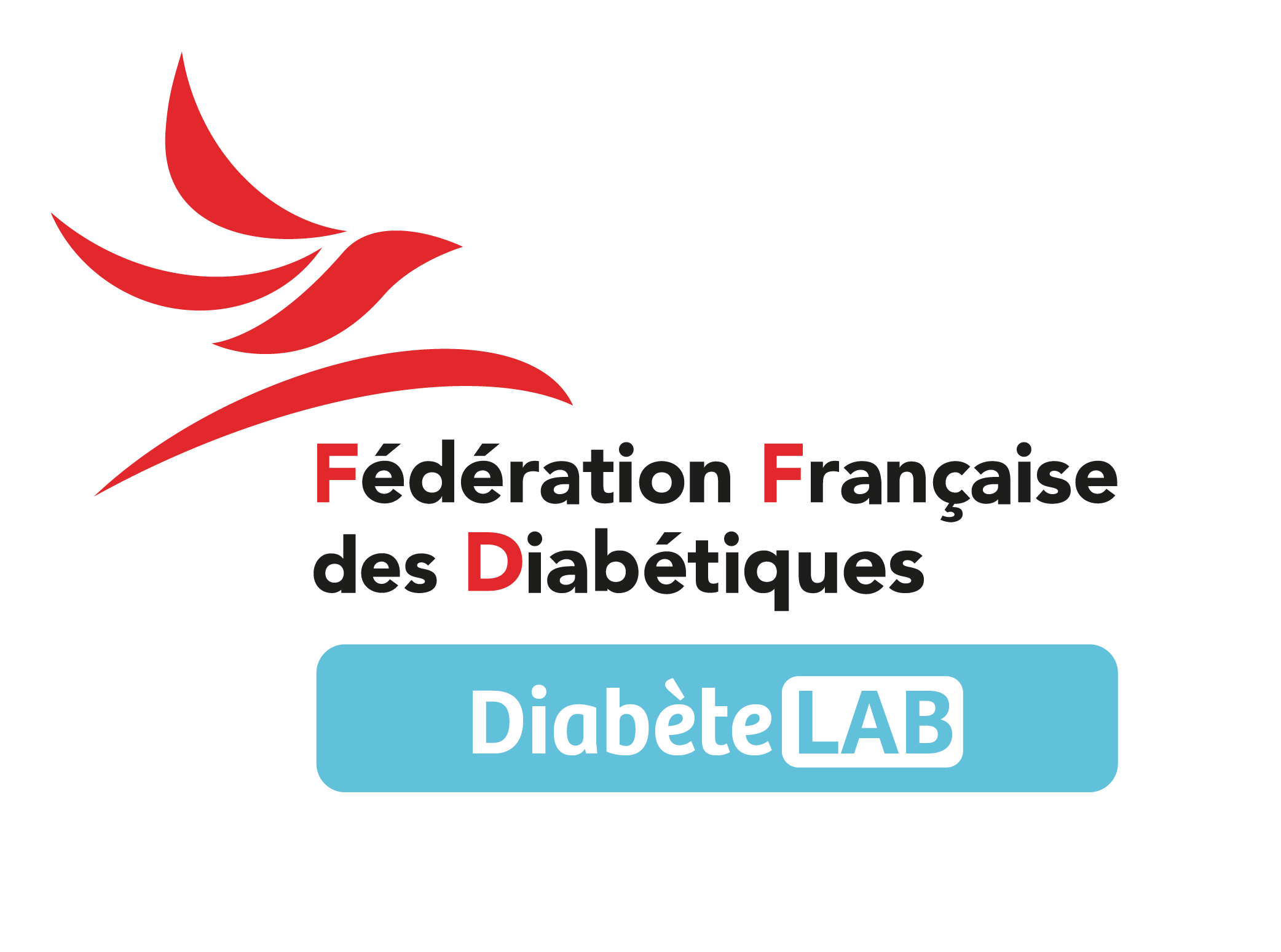Autrice : Marie Barroyer, doctorante en sociologie au Diabète LAB
Le Diabète LAB de la Fédération Française des Diabétiques regroupe des membres investis dans des recherches, dont plusieurs d’entre eux ont réalisés ou bien sont actuellement inscrits dans des travaux de thèse. À l’occasion de la Semaine Bleue, semaine nationale des personnes âgées et des personnes en situation de retraite, je vous propose ici de déconstruire quelques idées reçues sur les diabètes à partir de mon travail de thèse, dont vous avez déjà pu découvrir certains éléments dans un précédent article du Diabète LAB (insérer lien). La thèse porte sur le vieillissement avec un diabète et spécifiquement sur la manière dont l’avancée en âge joue sur le diabète. À ce titre, des exemples tirés des cas de personnes rencontrées au cours de l’enquête seront mobilisés dans la thèse afin d’illustrer certaines idées reçues. Des idées préconçues, qui vous diront surement quelque chose !
« Le diabète c’est une maladie de vieux »
Il existe plusieurs types de diabète, dont deux types principaux : le diabète de type 1 (DT1) et le diabète de type 2 (DT2), qui diffèrent tous deux, dans la majorité des cas, notamment par leur âge d’apparition. Ils diffèrent par des « causes physiologiques » et au sujet des raisons entrainant la survenue de la maladie.
Ainsi, le diabète peut survenir à différents moments de la vie, et ne se réduit pas à une pathologie du grand âge. En réalité, ce qui différencie souvent les parcours, c’est le temps passé avec la maladie. Certaines personnes ayant un diabète, dont des personnes âgées, vivent avec le diabète depuis plusieurs décennies : ce sont des « vieux diabètes », autrement dit des individus qui ont grandi, vieilli et traversé les étapes de leur vie avec la maladie. L’âge avancé n’est donc pas toujours un marqueur d’apparition de la maladie, mais peut aussi être le résultat d’un long vécu avec le diabète et l’acquisition d’expériences spécifiques.
« Les personnes âgées ne savent pas utiliser les nouvelles technologies »
C’est une idée assez répandue dans nos sociétés, mais la réalité est bien plus complexe. L’usage des technologies, dont les technologies de gestion des diabètes (lecteur de glycémie, pompe à insuline, boucle fermée), varie en fonction de plusieurs facteurs, comme le milieu social, le genre, ou encore le contexte de vie dans lequel se trouvent les personnes.
Dans le cadre de ma thèse, j’ai rencontré certains hommes âgés qui mobilisent les techniques et technologies liées à la gestion de leur diabète pour affirmer qu’ils ne sont pas « vieux » au sens social du terme, et qu’ils demeurent capables de maîtriser leur maladie. Cette mise en avant de leur compétence technique intervient parfois même dans leurs interactions avec les médecins, comme une manière de subvertir les rapports d’âge et de pouvoir qui s’exercent dans la relation de soin.
Si l’on s’intéresse maintenant au cadre de vie des personnes âgées, notamment dans les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), on observe que le contexte influence fortement la manière dont elles gèrent leur diabète. Au cours de mes enquêtes sur le terrain, j’ai notamment rencontré plusieurs résidentes, souvent des femmes, qui utilisent des lecteurs de glycémie – pour surveiller elles-mêmes l’évolution de leur diabète. Ces outils leur permettent d’ajuster leur alimentation au quotidien (une alimentation qui est en EHPAD contrainte), en choisissant par exemple de modifier ou d’éviter certains plats servis, selon le niveau de glycémie donné par le capteur.
Cette capacité à interpréter les données et à faire des choix alimentaires en conséquence constitue une forme d’autonomie dans la gestion de la maladie, et ceci même en institution. Ainsi, quand la médicalisation directe (comme l’auto-injection) n’est plus possible -en effet, en EHPAD, les injections sont réalisé par les infirmières- certaines personnes âgées trouvent dans la surveillance de leur glycémie une autre manière de rester actrices.
Pour certaines personnes âgées, le fait d’utiliser les technologies liées au suivi du diabète est aussi une manière de montrer qu’elles restent connectées au monde actuel, qu’elles sont encore capables de comprendre et de maîtriser des outils numériques. Au cours de mon travail de thèse, j’ai observé que, pour certains hommes âgés, le fait d’utiliser un lecteur de glycémie et d’avoir l’application de suivi installée sur leur téléphone était bien plus qu’un simple geste technique. C’était une façon d’affirmer qu’ils étaient toujours compétents, qu’ils savaient se servir des nouvelles technologies – parfois même aussi bien que leurs propres enfants, un effet de préservation de la masculinité-. Ce rapport à la technologie leur permettait ainsi de conserver une certaine place dans la hiérarchie familiale, notamment en tant que père. En montrant qu’ils savaient utiliser les applications ou interpréter les données numériques liées à leur diabète, ils se repositionnaient dans les rapports entre générations : non pas comme des personnes dépassées par le progrès, mais comme des individus pleinement en phase avec leur époque.
Ces éléments contredisent l’idée que toutes les personnes âgées seraient résistantes aux changements, aux nouvelles technologies. L’apprentissage et l’appropriation de ces technologies est un processus qui varie d’une personne à l’autre, notamment au vu du temps passé avec le diabète. Malheureusement, les stéréotypes liés à l’âge demeurent très présents dans nos sociétés, et ils se retrouvent parfois dans les discours de certains professionnels de santé ou du secteur médico-social, mais aussi dans ceux des proches. Ces représentations peuvent conduire à sous-estimer les capacités des personnes âgées, notamment en matière d’usage des technologies. Pourtant, les proches ne sont pas uniquement porteurs de ces stéréotypes : ils peuvent aussi jouer un rôle d’accompagnement essentiel, en aidant les personnes âgées à se familiariser avec les outils numériques liés à la gestion du diabète. En ce sens, ils peuvent devenir de véritables personnes ressources, facilitant l’appropriation des technologies et soutenant les personnes concernées et leur autonomie. Si le cliché selon lequel les personnes âgées seraient systématiquement en difficulté avec les technologies mérite d’être déconstruit, il ne faut pas pour autant nier que certaines d’entre elles, comme d’autres à tout âge peuvent effectivement rencontrer des obstacles dans leur usage.
« Les personnes âgées sont dépendantes et ne peuvent pas gérer seul.es leur diabète »
Certains clichés véhiculent l’idée que les personnes âgées ne peuvent plus s’occuper de leur diabète seules, mais c’est une vision simpliste. En réalité, la gestion du diabète peut évoluer selon le degré d’autonomie de la personne au quotidien, et sa capacité à s’occuper de sa maladie, c’est ce que les sociologues du vieillissement appellent les « prises » (Caradec, 2018).
Certaines tâches liées à la gestion du diabète peuvent être déléguées lorsque la personne en ressent le besoin ou le souhaite. J’ai observé que cette délégation peut prendre différentes formes. Par exemple, certains accompagnants aident la personne âgée à se rendre à ses rendez-vous médicaux, notamment lorsque conduire n’est plus possible. Ils peuvent aussi se charger d’aller à la pharmacie pour récupérer les médicaments ou encore faire les courses. Même si des aidants interviennent, qu’ils soient des aidants familiaux, ou même des aidants professionnels, cela ne veut pas dire que la personne perd toute son autonomie.
Nous pouvons alors parler d’« autonomie relationnelle » (Ennuyer, 2013), pour désigner que personne n’est totalement indépendant, chacun vit dans un réseau de relations. Même si une personne âgée rencontre des difficultés, par exemple physiques, elle peut continuer à faire des choses, comme surveiller son alimentation, prendre ses médicaments, et garder des rôles sociaux, comme celui de père, de mère et/ou de grands parents.
Parfois, certaines personnes choisissent de manière volontaire de déléguer certains actes. J’ai notamment eu le cas d’une dame âgée vivant seule à domicile qui préfère qu’une infirmière fasse les injections d’insuline. Elle en était pourtant capable d’un point de vue physiologique, mais elle préférait garder ce lien social pour discuter d’autres choses, pour partager un café et des moments de convivialité. Ce sont des stratégies réfléchis, qui montrent qu’autonomie ne veut pas toujours dire « faire par soi-même ».
Ces récits invitent à repenser l’autonomie, souvent confondue avec l’indépendance totale, l’autonomie peut s’exercer avec les autres, et avec son vieillissement. Les personnes âgées peuvent mettre en place des stratégies d’adaptation, de délégation choisie, qui leur permettent de maintenir des repères, des liens sociaux, et des rôles familiaux. Déléguer un soin ou une tâche ne signifie pas renoncer à son autonomie, mais peut au contraire en être une expression : celle d’un choix de vie.
« Le sport, c’est seulement pour les jeunes ! »
Dans les représentations sociales, l’activité physique reste souvent associée à la jeunesse, à la performance ou à une quête de l’ordre de l’esthétique, et/ou d’une certaine vision des corps représentant la bonne santé. Vieillir reviendrait alors à « ranger ses baskets », à se retirer du monde du mouvement, comme si la seule chose attendue du grand âge était la prudence. Cette idée reçue est ancrée dans une vision âgiste du corps vieillissant.
Loin d’être réservée aux plus jeunes, l’activité physique est un levier thérapeutique central dans le traitement des diabètes, au même titre que l’alimentation ou que les traitements médicamenteux. Elle contribue directement à l’équilibre glycémique, et peut prévenir certaines formes de perte d’autonomie. Bouger au quotidien, entretenir sa mobilité, monter des escaliers, jardiner, marcher régulièrement, tout cela relève déjà de l’activité physique.
Dans certains cas, ces efforts sont facilités par un accompagnement et par une acticité physiques « adaptée », qu’il soit professionnel ou institutionnel ajustant les mobilisations en fonction de l’âge, des normes sociales, et des pathologies associées. En EHPAD, par exemple, le maintien de certaines activités, comme la gymnastique assise, le vélo, la couture ou le bricolage, contribue à une forme de mobilisation corporelle. Ces pratiques permettent aux résidents de rester actifs et offrent un moyen d’exercer un certain contrôle sur leur corps, en lien avec leur état de santé. Il y a aussi des personnes âgées avec des usures physiologiques qui souhaitent ne pas être soumis à l’injonction du mouvement, cela pourra être développé et déconstruit dans le cadre de ma thèse.
À travers ces différentes idées reçues, une chose devient évidente : il est temps de déconstruire les représentations simplistes qui entourent les personnes âgées atteintes d’un diabète. Ce que montrent les recherches menées sur le terrain, c’est que la réalité est bien plus nuancée, riche, et surtout profondément humaine.
Les personnes âgées vivent des parcours de vie différents, avec des expériences variées du diabète : certaines ont été diagnostiquées jeunes, d’autres plus tardivement ; certaines préfèrent rester très autonomes, d’autres choisissent volontairement de déléguer certaines tâches.
En mettant en lumière ces réalités vécues, cette réflexion invite à changer notre regard sur le vieillissement et la maladie chronique. Mieux comprendre les besoins, les capacités, mais aussi les stratégies d’adaptation des personnes âgées permettent non seulement de lutter contre les stéréotypes âgistes, mais aussi de construire une prise en charge au plus près des parcours de chacun.es.
Références :
CARADEC, Vincent. Intérêt et limites du concept de déprise. Retour sur un parcours de recherche. Gérontologie et Société, 2018, vol. 40, no 155(1), pp. 139-147.
ENNUYER, Bernard. Les malentendus de l’« autonomie » et de la « dépendance » dans le champ de la vieillesse. Le Sociographe, 2013, vol. 6, no 5, pp. 139-157.
Ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. Diabète, 2025 [en ligne] [consulté le 21 juillet 2025]: https://sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/article/diabete.