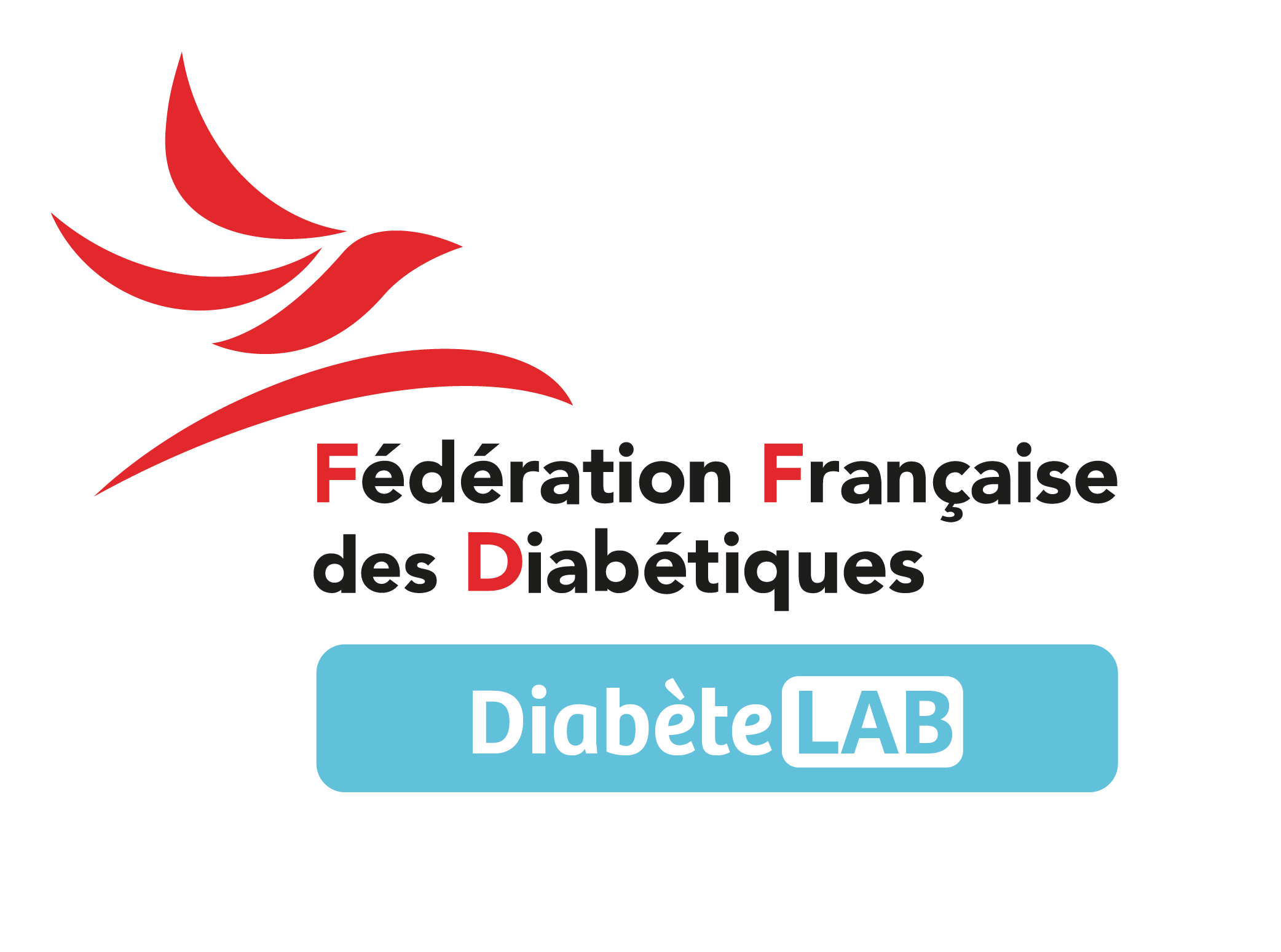Le Diabète LAB de la Fédération Française des Diabétiques regroupe des membres investis dans des recherches innovantes, dont plusieurs ont entrepris ou achèvent actuellement des travaux de thèse. Afin de mettre en lumière ces parcours enrichissants, nous avons le plaisir de vous présenter, dans une série d’articles, les doctorants et doctorantes qui contribuent à la réflexion et aux actions du Diabète LAB.
Nous débutons cette série avec Marie Barroyer, sociologue et doctorante en sociologie, qui a rejoint le Diabète LAB en octobre 2024. À travers ses recherches, elle explore des enjeux cruciaux liés au vieillissement et aux diabètes, apportant un éclairage sociologique précieux sur des questions qui touchent directement les personnes touchées par la maladie, leurs proches et les professionnels de santé.
Peux-tu nous expliquer l’objectif principal de ta thèse et ce qui t’a motivée à choisir ce sujet ?
L’objectif principal de ma thèse est d’explorer les expériences de vie avec les diabètes dans l’âge avancé, en examinant le vécu quotidien des personnes et les « bouleversements » que les diabètes peuvent entraîner à différentes étapes de l’avancée en âge. Mon projet s’intéresse particulièrement à la manière dont des transitions spécifiques, telles que la retraite, la perte ou la modification de l’autonomie, le veuvage ou encore l’entrée en institutions d’hébergements influencent les expériences des personnes -mais aussi de leur entourage- et redéfinissent des pratiques de gestion de la maladie et de la vie.
De ce fait, je porte également une attention particulière à l’impact des accompagnements, qu’ils soient médicaux, familiaux ou entre pairs, sur la gestion des diabètes et sur les manières de vivre et de « faire avec ».
Mon choix de sujet de thèse est profondément ancré dans mon intérêt pour la sociologie et mon désir de contribuer à une meilleure compréhension des dynamiques sociales liées aux diabètes, en particulier chez les personnes âgées, souvent invisibilisées dans les recherches. Ce sujet résonne avec mon parcours personnel, puisque deux personnes de mon entourage sont atteintes d’un diabète. Ce vécu quotidien m’a sensibilisé à cette maladie et m’a donné envie de partager des clés de compréhension qui mettent en lumière les réalités souvent oubliées des populations âgées confrontées aux diabètes et aussi de leurs aidants.
Quels aspects du vieillissement et du diabète explores-tu plus précisément dans tes recherches ?
Tout d’abord je tiens à préciser que je m’intéresse aux personnes touchées de diabète de type 1 et de type 2 car ce sont des vécus du diabète différents, mais tous deux enrichissants pour mon sujet car ils sont complémentaires. Sur le vieillissement, je vais questionner l’impact des représentations sociales de l’âge avancé et comment cela se répercute sur les prises en charge réalisées par les professionnels de santé. Par exemple je vais questionner comment se configure le choix du traitement, et d’interroger au-delà du biologique l’importance et l’impact du social.
L’exemple de la retraite est intéressant, en redéfinissant un rapport au temps, à la santé et surtout au travail de gestion de la maladie réalisé par les personnes. Selon les milieux sociaux et les conceptions différenciées de la retraite, il est possible d’observer des manières variées de composer avec la maladie durant cette période, ce qui peut parfois conduire à de nouvelles manières de vivre avec la maladie. Ces différences s’expriment à travers des pratiques de gestion des diabètes qui reflètent les ressources matérielles, culturelles et symboliques des individus, et peuvent venir exacerber les inégalités sociales en matière de santé.
En quoi ton approche sociologique apporte-t-elle une nouvelle perspective sur la gestion du diabète, en particulier chez les patients âgés ?
Mon approche sociologique apporte une perspective nouvelle en croisant deux champs rarement associés -en tout cas pour ce qui est de la sociologie française- : la sociologie du vieillissement et la sociologie des maladies chroniques. Jusqu’à présent, ce croisement a principalement été exploré dans le champ de la jeunesse, notamment par l’équipe de chercheurs de Strasbourg avec les travaux de Lydie Bichet, docteure en sociologie. En revanche, les personnes âgées, pourtant confrontées à des sujets similaires –tels que la redéfinition de leur autonomie, l’adaptation aux changements sociaux et corporels, ou encore l’articulation des soins dans un cadre familial– restent largement sous-étudiées. Ce qui est quelque peu en inadéquation avec la réalité démographique de la population atteinte de diabètes.
Quels sont selon toi, les principaux défis rencontrés par les patients âgés atteints de diabète, les proches et les professionnels de santé dans leur quotidien ?
Un premier défi réside dans l’adaptation des manières de prendre en charge les personnes âgées atteintes de diabètes, notamment de par les dispositifs médico-techniques et de par les pratiques d’éducation thérapeutique, qui doivent être adaptés aux réalités du vieillissement mais également aux personnes âgées elles-mêmes. Les dispositifs médico-techniques -comme les pompes à insuline-, peuvent devenir difficiles à manipuler pour des personnes âgées du fait par exemple d’une perte d’acuité visuelle. Mais inversement, les dispositifs et les manières de prendre en charge peuvent souligner la persistance de l’âgisme[1] dans notre société actuelle et dans les pratiques des professionnels de santé. Trop souvent, les prises en charge tendent à homogénéiser les besoins des âgés ou à les réduire à leur vulnérabilité, en supposant qu’elles sont moins capables d’apprendre ou de s’adapter à de nouvelles technologies, alors que cela dépend évidemment de chaque personne.
Un autre enjeu majeur concerne la reconnaissance et le rôle des proches aidants, souvent des femmes (épouses, filles, voisines), qui assument une grande part du « travail de care[2] » : préparation des repas, suivi médical, soutien émotionnel ; leur contribution, pourtant essentielle, reste fréquemment invisibilisée…
Comment tes recherches contribuent-elles aux réflexions et aux actions menées par le Diabète LAB ?
Car mes recherches explorent des thématiques spécifiques et encore sous-investies, notamment la gestion des diabètes chez les personnes âgées. Ma thèse permet de réaliser des entretiens plus longs avec les participants, et permet aussi d’inclure des personnes qui n’entretiennent pas de lien avec la Fédération Française des Diabétiques de par mon réseau d’interconnaissance.
Le Diabète LAB, qui s’attache à comprendre les besoins des patients et surtout les différents vécus avec la maladie, peut bénéficier de mes travaux en intégrant une perspective sociologique centrée sur les réalités du vieillissement et sur les transitions de vie liées à l’âge avancé.
Quels impacts concrets espères-tu pour les personnes atteintes de diabète grâce aux résultats de tes travaux ?
J’espère que mes recherches influenceront les pratiques en matière de soins et permettront de déconstruire certains stéréotypes associés aux personnes âgées, tout en orientant les accompagnements vers des approches plus personnalisées et adaptées. Par le biais des entretiens, je souhaite également offrir aux personnes un espace d’expression, leur donnant ainsi la parole et une forme de pouvoir pour partager leurs vécus.
Pourquoi est-il important pour une structure comme le Diabète LAB de soutenir des recherches doctorales comme la tienne ?
Elles permettent de créer des ponts entre le monde académique et les organisations associatives qui œuvrent directement sur le terrain. En finançant des recherches plus académiques, comme celles qui sont menées dans le cadre d’une thèse, la Fédération Française des Diabétiques soutient la production de connaissances, cruciales pour comprendre les réalités sociales et humaines vécues par les personnes atteintes de diabètes. Le financement de ces recherches permet de dégager du temps pour mener des recherches qualitatives davantage détaillées sur des aspects spécifiques du vieillissement, et d’approfondir des problématiques qui ne sont souvent pas suffisamment étudiées.
Quel message souhaites-tu adresser aux personnes atteintes de diabète ou à leurs proches qui pourraient se reconnaître dans les thématiques de votre travail ?
Je souhaite adresser un clin d’œil si on peut dire cela ainsi et surtout un message de soutien à toutes les personnes atteintes de diabètes et à leurs proches qui pourraient se reconnaître dans les thématiques de ma recherche. Vos expériences quotidiennes m’intéressent et sont au cœur de mes travaux, avec cette recherche, je m’efforce de mettre en lumière ces aspects parfois invisibles.